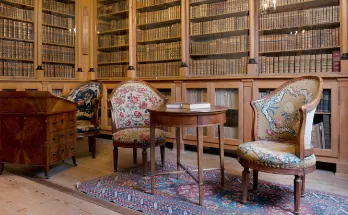Édité par l’Association culturelle pour le voyage en Suisse, ce petit opuscule ne paie pas de mine mais fourmille d’informations et d’anecdotes amusantes. Il se propose d’aborder l’histoire du voyage par le biais d’une série d’objets dont la plupart datent du XIXe siècle.
Dans un premier temps, trois d’entre eux nous emmènent à la conquête des Alpes. Il s’agit de la boussole de poche en argent avec un cadran solaire d’Horace Bénédict de Saussure, de l’alpenstock d’Edward Whymper sur lequel sont gravés les noms des lieux qu’il a visités, enfin du livre du guide de Peter Knubel. Ce carnet était un élément essentiel de l’équipement d’un guide de montagne. Réunissant les témoignages et les recommandations des clients, il servait en quelque sorte de curriculum vitae.
Autres témoins des déplacements des voyageurs, les passeports et les visas. On apprend à cette occasion qu’il fut un temps où il fallait un visa sarde pour se rendre de Genève à Chamonix, la Savoie relevant alors de la juridiction du royaume de Sardaigne. Comme les tampons des douanes, les étiquettes à bagages collées par les hôtels sur les valises font, elles aussi, de très beaux souvenirs. Enfin, l’équipement était essentiel pour réussir l’escapade et, sur ce point, les guides de l’époque se montraient généreux en conseils. À la fin du XVIIIe siècle, on préconisait, pour marcher, de préférer le pantalon à la culotte ainsi qu’un frac fort court, ou jaquette. En 1869, le célèbre guide Baedeker s’attardait longuement sur la garde-robe féminine, recommandant une ceinture élastique qui permettait de relever les jupes et de libérer ainsi le mouvement. / Mireille Descombes

Le vandalisme dans la littérature
«Ce livre risque d’en irriter plus d’un », prévient l’historien de l’art Philippe Junod dans l’avant-propos. Autre précision, il ne s’agit pas ici d’une histoire du vandalisme, mais bien d’une anthologie de textes significatifs illustrant les diverses formes que peuvent prendre le phénomène et sa perception.
Après une évocation des «prémices et prototypes», l’ouvrage s’arrête longuement sur les désastres de la guerre, notamment pour déplorer avec Albert Camus, au lendemain d’Hiroshima, une civilisation parvenue «à son dernier degré de sauvagerie». D’autres chapitres s’intéressent à la défense du patrimoine, portée notamment par Victor Hugo, et aux grands débats concernant l’éthique de la conservation et la déontologie de la restauration. La modernité, elle aussi, n’en finit pas de blesser les regards, qu’il s’agisse de déplorer la mort du Caire avec Pierre Loti ou de stigmatiser les dégâts du tourisme dans les Alpes avec Marguerite Burnat-Provins. Et le livre s’achève avec un «lamento sur Lausanne», cité que Ramuz voyait comme «une ville qui a mal tourné». / MD
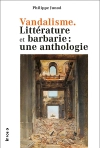
Notice sur LabeLettres, site de la Faculté des lettres
De filles en aiguilles
Olga est partie pour un long voyage en Asie avec le beau Mats. Elle en revient avec Sélène. Les jeunes amoureuses débarquent en fanfare dans l’appartement parisien du père d’Olga, le narrateur. Ce dernier, un documentariste célibataire, traînait jusqu’alors dans la grisaille. Comme il le dit, «depuis le départ de Sylvie avec un maître-nageur de dix ans son cadet, ma joie de vivre avait baissé d’un cran». L’allégresse dégagée par le duo va-t-elle disperser les nuages? Ce serait trop simple. Comme un poison, le doute se répand petit à petit dans les pages du roman de Michel Layaz, licencié en Lettres de l’UNIL.
Si les liens familiaux constituent le thème principal du livre, quelques beaux passages sont consacrés à l’art brut, via le personnage d’«Amandin». Ce sans-abri parisien s’avère être un artiste stupéfiant. Le narrateur ne pourrait-il pas lui consacrer un film et jouer de ses contacts pour monter une exposition? On reconnaît quelques personnalités du domaine, liées à Lausanne, dans le texte. DS