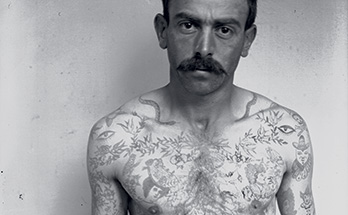Doctorante à l’École des sciences criminelles, Giulia Cinaglia termine sa thèse qui porte sur les «cold cases», soit les affaires non élucidées. Comment travaillent les différentes polices, à quelles difficultés sont-elles confrontées et quels éléments permettent de résoudre ce genre d’affaires? Rencontre avec une passionnée de faits divers.

Plus de 120 cambriolages, 51 viols, 13 meurtres. Durant plus de quarante ans, en Californie, une génération entière a été terrorisée par une série d’affaires non résolues. Et puis, en avril 2018, une arrestation, celle d’un ancien policier de 72 ans. Confondu par son ADN, il avoue. Joseph James DeAngelo, alias The Golden State Killer, sera condamné en août 2020 à onze peines de prison à perpétuité.
Si cette série de cold cases a hanté la Californie, elle est aussi la preuve qu’il ne faut jamais perdre espoir. L’avancée de la science, la création de banques de données, le hasard, la chance, mais surtout le travail de la police permettent d’arrêter les criminels qui pensaient être passés entre les gouttes.
Giulia Cinaglia est bien placée pour le savoir. Cette doctorante de l’École des sciences criminelles consacre sa thèse à ce type d’affaires, et elle est à bout touchant. Elle a interrogé des représentants de diverses polices en Suisse romande, en France et au Canada pour comprendre et décortiquer le travail des policiers et experts qui interviennent dans ce genre de cas.
Si la jeune femme s’est toujours intéressée aux enquêtes et aux faits divers, c’est en regardant un documentaire sur JonBenét Ramsey – une mini Miss de 6 ans dont la mort n’a toujours pas été élucidée – qu’elle s’est découvert une passion pour les cold cases. Dans ce film, une équipe composée de médecins légistes, d’anciens «forensiciens» et de policiers essaie de reconstruire les faits pour pouvoir comprendre leur déroulement, et potentiellement remonter à l’auteur présumé de l’homicide. «Je me suis dit: “C’est vraiment incroyable les cold cases!”. C’est comme cela que tout a commencé.»
Objet flou
Contrairement à ce que pourraient imaginer les fans de la série télévisée Cold Case: affaires classées, ce n’est pas l’inspectrice Lilly Rush et sa brigade qui sont à l’origine du terme cold case. Giulia Cinaglia explique. «Cette notion apparaît pour la première fois en 1997, dans un article de Charles Regini, un agent du FBI. Il y présente le concept de Cold Case Homicide Squad, une équipe qu’il a mise sur pied cinq ans auparavant, au sein de la Metropolitan Police de Washington.» Au fil de ses interviews, la doctorante s’est rendu compte que le cold case est «un objet qui reste flou». Aux États-Unis, certaines juridictions n’incluent que les homicides, d’autres prennent également en compte les infractions à l’intégrité sexuelle. Quant au pôle français dédié à ce genre d’affaires, il inclut les disparitions inquiétantes. Mais alors, qu’est-ce qu’un cold case? «En simplifiant, je dirais que c’est une affaire criminelle grave dont l’auteur présumé n’a pas été identifié et, par extension, arrêté.» Si le terme est récent, la notion est «vieille comme l’homme», détaille encore Giulia Cinaglia qui évoque notamment le cas de Jack l’Éventreur. «Auparavant on parlait de unsolved murder, de meurtres non résolus.»
L’apparition du terme cold case n’est pas anodine. Il est lié à l’évolution de la criminalité aux États-Unis: elle a augmenté et s’est complexifiée à partir des années 60, avec des pics dans les années 80-90. «Cette augmentation, couplée à une complexité des homicides qui commençaient à être perpétrés en dehors du cercle familial, dans le cadre d’activités criminelles avec des armes à feu, a conduit à une baisse du taux d’élucidation des cas.»
Manque de pistes
Au nombre et à la complexité des cas viennent s’ajouter d’autres facteurs. Parmi les raisons qui transforment une affaire en cold case: le manque de pistes. «Parfois, il est très difficile de savoir par où commencer pour trouver des suspects. Un autre facteur récurrent est le manque d’éléments de preuve ou l’impossibilité de les exploiter.» Le travail sur la scène de crime comporte son lot d’adversités. Lorsque les policiers arrivent sur un tel lieu, ils travaillent par hypothèses pour déceler les traces, particulièrement celles qui ne sont pas visibles. «Ils agissent dans le doute, finalement. Ils pensent que les traces qu’ils prélèvent sont pertinentes et leur apporteront des éléments utiles. Mais ils vont peut-être se retrouver face à des traces dégradées, polluées, ou qui s’avéreront non pertinentes pour différentes raisons.»
Le facteur humain pèse également dans la balance. «Si, au début de l’enquête, le curseur n’a pas été posé correctement, ou que la difficulté du cas a été sous-estimée et que le travail réalisé n’était pas exhaustif, cela peut avoir une incidence sur la suite. Car ce qui a été perdu le sera, parfois, pour toujours. Typiquement, si une scène de crime est à l’extérieur, elle peut être modifiée par des intempéries ou d’autres facteurs.»
Pour lutter contre l’errance de ces innombrables affaires, certains pays ont mis sur pied des unités spéciales. C’est le cas de la France qui, au printemps 2021, a créé la Division des affaires non élucidées (DiANE) au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à la suite de l’affaire Nordahl Lelandais. «Quand la police est tombée sur cet individu, elle s’est rendu compte que son profil était très particulier, et qu’il méritait peut-être une analyse plus approfondie. La cellule Ariane a donc été créée pour analyser son parcours de vie, et remonter le fil de ses déplacements.» Les policiers ont cherché s’il y avait des cas de disparitions ou de meurtres non élucidés dans les endroits qu’il avait fréquentés. C’est ainsi qu’ils ont relié certains dossiers à Nordahl Lelandais.
Comme la cellule Ariane avait donné des résultats, ils ont décidé de continuer le travail et d’en faire une division à part entière nommée DiANE. De telles unités existent depuis de nombreuses années, voire décennies, au Canada, aux États-Unis, en Italie ou en Angleterre. Giulia Cinaglia explique. «Ces brigades ad hoc répondent visiblement à une volonté politique d’attribuer des finances pour faire avancer ces affaires.»
La Suisse, elle, ne compte pas de telles unités. Lors de ses recherches et entretiens, la doctorante a constaté que dans notre pays, les cas ne faisaient pas l’objet d’un réexamen systématique. «En Suisse, la reprise de cold cases est quelque chose d’essentiellement opportuniste. Seule une nouvelle source d’information, un nouvel élément comme, par exemple, une correspondance dans une banque de données, va relancer l’affaire.» Et si le mystère qui entoure un homicide ou une disparition hante les familles, il est également pesant pour les forces de l’ordre. Giulia Cinaglia a même rencontré un policier qui, touché par un cas, reprenait ses propres recherches lorsque les affaires courantes lui en laissaient le temps.
Résoudre des affaires non résolues, on imagine l’ampleur de la tâche. De nombreux obstacles se dressent sur la route des enquêteurs. Giulia Cinaglia rappelle que lorsqu’un policier reprend un cas, il n’est pas entièrement maître du dossier, notamment pour ce qui est des informations collectées et de la manière dont elles l’ont été. Il est souvent tributaire du travail déjà accompli. «En fait, il travaille avec des données de seconde main. Ces dernières peuvent être excellentes. Mais il se peut que, dans le puzzle, il manque des pièces. Le policier aura beau essayer de le terminer, s’il y a des éléments qui n’ont pas été recueillis en amont, il sera bien plus difficile de résoudre l’affaire.»
Progrès scientifiques…
Heureusement, au fil des années, les progrès scientifiques, que ce soit au niveau des technologies à disposition ou la création de banques de données, ont permis d’avoir un catalogue de personnes d’intérêt, rappelle Giulia Cinaglia. À cela s’ajoutent les avancées de la recherche sur ADN qui s’est développée au début des années 90. «À l’époque, pour pouvoir obtenir un profil génétique, il fallait une quantité assez élevée de matériel biologique. Aujourd’hui, il ne faut plus que des quantités infimes, parce que la sensibilité des techniques a évolué.»
Ce sont ces avancées qui ont permis de confondre Joseph James DeAngelo, alias The Golden State Killer. Giulia Cinaglia raconte. «Cette affaire connaît un premier rebondissement au début des années 2000. La recherche sur l’ADN a progressé; l’analyse de prélèvements effectués sur de nombreuses scènes de crimes, tous commis en Californie entre 1974 et 1986, permet de conclure que le criminel n’est qu’un seul et même homme.» Jusque-là, les policiers pensaient que ces crimes étaient l’œuvre de plusieurs individus, surnommés Visalia Ransacker, East Area Rapist, Original Night Stalker ou encore Diamond Knot Killer.
Après d’infructueuses années de recherches, l’ADN indiciaire ne donnant lieu à aucune correspondance dans les banques de données de police, la chance change de côté: l’affaire connaît un deuxième rebondissement. «En 2016, les Autorités se penchent à nouveau sur le dossier du Golden State Killer et décident d’exploiter GEDmatch, une banque de données généalogiques en libre accès.» À l’origine, elle était destinée aux généalogistes et aux particuliers pour trouver des membres de leur famille. Bingo! GEDmatch révèle plusieurs parents du tueur-violeur en Californie. Ces personnes sont des cousins au 3e degré. La police remontera la piste pour aboutir à un nom: Joseph James DeAngelo. Avant de l’arrêter, les policiers recueilleront discrètement son ADN sur la portière de sa voiture, et sur un mouchoir qu’il jette à la poubelle devant chez lui. Cet ancien policier, qui avait été licencié pour vol, avouera tous ses crimes.
… Mais avec des limites
Mais si les progrès de la science permettent de relancer une enquête et même de trouver une personne d’intérêt, tout n’est pas gagné d’avance. Giulia Cinaglia détaille l’affaire d’un diplomate égyptien tué à Genève, en 1995. Le corps de cet homme est retrouvé dans le parking de son habitation, criblé de six balles. Sur les lieux, la police a retrouvé un silencieux artisanal, assemblé à partir d’appuie-têtes de voiture, scotchés ensemble. «À l’époque, les analyses avaient permis de mettre en évidence une trace digitale et quatre profils ADN sur le ruban adhésif, mais il n’y avait pas d’autres éléments, parce que l’arme du crime n’a jamais été retrouvée.» Plus de vingt ans s’écoulent, sans que le mystère sur cette mort ne soit levé. Puis un jour, la mise à jour de l’algorithme d’AFIS, le Système automatique d’identification des empreintes digitales, enclenche une nouvelle analyse des traces. La police obtient une concordance, un hit comme disent les spécialistes, et donc une personne d’intérêt. Giulia Cignaglia explique. «Ce cas est passionnant, parce qu’il nous montre les limites de la science. La science a en effet besoin d’être étayée par le travail d’enquête traditionnel pour contextualiser la trace, et lui donner un sens.» L’homme a été interpellé, placé en détention préventive, puis il a été confronté, en photo, à la trace digitale, mais il s’est déclaré absolument étranger à l’homicide. «Les enquêteurs ont continué les investigations pour essayer de le placer sur la scène de crime, mais à ce jour ils n’ont pas réussi à cumuler suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir le traduire en justice. Cet homicide reste donc un cold case.»
Coup de pouce du hasard
Outre la science, d’autres facteurs permettent de sortir des cold cases de leur torpeur. «Lors de conférences, des personnes m’ont demandé s’il est possible de résoudre des affaires non élucidées par hasard. La réponse est oui! Et certains représentants de corps de police que j’ai interrogés me l’ont confirmé, notamment dans le cas de la criminalité organisée», précise la doctorante. Un exemple? Un individu est arrêté pour ses activités dans le cadre d’un réseau criminel. Soit par vengeance à l’encontre d’un ancien chef ou d’une bande rivale, la personne dira: “Ce meurtre- là, je vais te dire qui c’est”. Il arrive également qu’un meurtrier soit pris de remords et décide de passer aux aveux.»
Mais dans les faits, si ce genre de hasard est une manière d’avoir une information, il reste aux policiers à faire encore tout le travail de corroboration des aveux. À eux de déterminer s’il existe des preuves, s’il s’agit de la vérité ou si ce sont de faux aveux. Parfois, c’est également le hasard qui permet de mettre la main sur une pièce du puzzle importante, et résoudre ainsi une série d’affaires non élucidées. C’est justement un événement imprévu qui a permis de faire la lumière sur l’homicide de deux jeunes Françaises. Leurs corps avaient été retrouvés juste au-delà de la frontière belge, en 2000 pour Céline Saison, et en 2001 pour Mananya Thumpong. Les policiers n’avaient alors pas de piste et n’arrivaient pas à établir de liens entre ces deux meurtres. Giulia Cinaglia raconte la suite: «En 2003, une jeune fille belge est enlevée par un homme au volant d’une camionnette. Elle arrive à s’enfuir et, le temps que l’homme s’en rende compte, elle est secourue par une automobiliste qui la conduit au poste de police. En route, la jeune victime voit la camionnette. Les deux femmes arrivent à prendre le numéro de plaque.» Grâce à ce numéro, la police remontera jusqu’à l’identité du propriétaire du véhicule: une certaine Monique Olivier. Les policiers belges s’intéresseront de plus près à son conjoint: Michel Fourniret. «À ce moment-là, les enquêteurs avaient déjà formulé l’hypothèse d’un lien entre la tentative de kidnapping de cette jeune fille belge, et les deux cadavres qui avaient été retrouvés à la frontière belge.» Après plusieurs auditions, mise sous pression, Monique Olivier mettra son mari en cause pour dix meurtres, dont celui de Céline Saison et Mananya Thumpong. On connaît la suite.
La prescription, une notion variable
S’il y a une notion importante liées aux cold cases, c’est bien celle de la prescription. Elle varie d’un pays à l’autre. Au Canada, comme c’est la police qui s’occupe entièrement de l’enquête – le procureur n’intervient qu’au moment de porter les charges contre la personne – il n’y a pas de décision de classement pour un dossier. «Une affaire reste ouverte, ad vitam aeternam, dans la mesure où les crimes de sang ne connaissent pas de prescription dans les pays sous Common law», explique Giulia Cinaglia.
En Suisse par contre, des délais sont fixés: la prescription dépend de la peine maximale encourue. Le délai est de 30 ans, s’il s’agit d’une peine privative de liberté à vie. Il est de quinze ans, si la peine maximale encourue est de plus de trois ans. Giulia Cinaglia rappelle le débat parlementaire qui a eu lieu en 2016, autour de la proposition d’instaurer l’imprescriptibilité pour certains crimes. Le Conseil fédéral s’était prononcé contre cette proposition. La raison? «D’une part, on estime que la science a bénéficié de telles évolutions que le délai octroyé est suffisant pour pouvoir résoudre une affaire. Et d’autre part, d’un point de vue philosophique, on considère que, finalement, le temps soigne les blessures et joue le rôle de pacificateur social. Évidemment, la prescription n’est pas un pardon. Mais on estime que le criminel vit avec une sorte d’épée de Damoclès sur la tête et sait qu’à tout moment, il pourra être rattrapé pour ce qu’il a fait. C’est une punition morale.» Quarante ans avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c’est ainsi qu’a vécu le Golden State Killer. Au moment de son arrestation, il avait passé le plus clair de sa vie en liberté. Giulia Cinaglia constate: «Quand la police est allée le chercher, devant elle, elle n’avait plus le monstre qui a tué des pères de famille et violé des femmes, mais un papy qui tondait la pelouse.» À la base, les procureurs voulaient demander la peine de mort. Finalement Joseph James DeAngelo a pu négocier: il a reconnu ses actes et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. «La personne a donc été sanctionnée. Mais quel sens donne-t-on à la sanction, lorsque 40 ans se sont écoulés? Pour la société, cela peut signifier que les Autorités vont jusqu’au bout. Le message transmis est: vous n’aurez pas la paix, tant qu’on ne vous aura pas trouvé.»
Pas d’effet dissuasif
Mais la criminologue ne pense pas que cette condamnation ait un effet dissuasif sur les futurs criminels. Quant à la fonction de réhabilitation de la peine, Giulia Cinaglia n’y croit pas non plus, car le Californien avait arrêté de commettre des crimes depuis 40 ans. Elle ne pense pas non plus que la prison aura une fonction neutralisatrice, parce que la personne ne représentait plus une menace pour la société. Et il ne s’agit pas non plus de la resocialiser. «Nous sommes là dans une idée de châtiment: à tel acte correspond telle sanction. C’est peut-être pour ça que de nombreux pays, dont la Suisse, accordent beaucoup d’importance à la question de la prescription pénale.»/
Les cold cases en chiffres
«Etant donné que la définition de cold case n’est pas univoque et varie d’un pays à l’autre – voire d’une juridiction à l’autre, notamment aux États-Unis – il est très difficile de comptabiliser les cas», constate Giulia Cinaglia. La doctorante a cependant recueilli quelques statistiques auprès des polices qu’elle est allée interroger. À la police de la ville de Toronto, en 2018, on comptait environ 600 cas. Et au Québec, comme en France, les polices ont répertorié environ 700 cold cases.
En Suisse, ce chiffre n’est pas connu pour l’ensemble du pays. Cependant, une étude réalisée en 2019 auprès de la Police neuchâteloise en collaboration avec l’École des sciences criminelles, a permis d’identifier 55 dossiers non résolus dans le canton. «Ce chiffre comprend un homicide, des viols et des attaques à main armée (environ 25), alors que dans d’autres pays, ces dernières ne sont pas considérées comme des cold cases.» Il faut dire que la Suisse ne comptabilise qu’une cinquantaine d’homicides par année, ce qui est très peu. « En 2021, le taux d’élucidation était de 97,6%, alors qu’en Europe, il avoisine les 60%. Dans notre pays les homicides sont essentiellement commis dans la sphère familiale, ce qui facilite grandement la résolution d’une affaire.»/