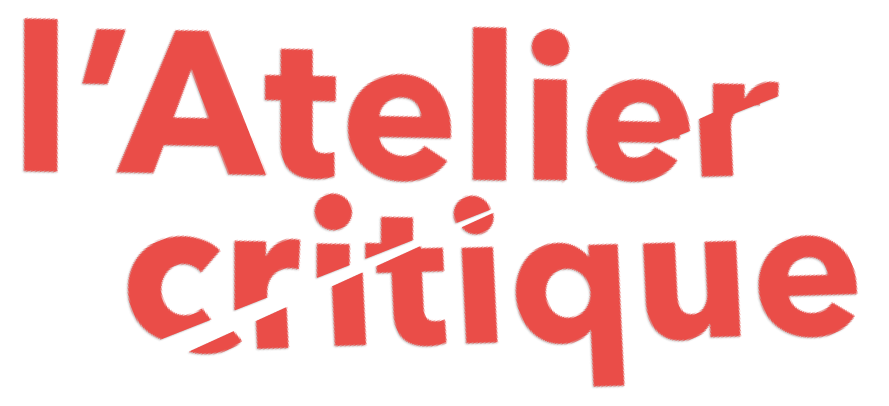Par Julie Fievez
Une critique sur le spectacle :
Liebestod / Par Angélica Liddell / Théâtre de Vidy / du 15 au 18 mars 2023 / Plus d’infos.

En proposant un hommage au torero Juan Belmonte, la nouvelle création d’Angélica Liddell s’inscrit dans le cycle « Histoire(s) du théâtre » initié par Milo Rau. Dans ce troisième volet, la performeuse réinterprète le prélude « Liebestod » de Wagner – littéralement « la mort d’amour ». Malgré l’incroyable puissance du cri adressé au public, le spectacle peine parfois à toucher le cœur – quelque peu retourné – des spectateur·ice·s.
Le spectacle d’Angélica Liddell – artiste espagnole, autrice, metteuse en scène et interprète de ses propres créations – débute sur trois instants suspendus, presque photographiques : un homme, torse nu et barbe longue, apparait. L’un des tableaux le présente tenant des chats en laisse, tel un dresseur. Autour de lui, un décor dans les jaunes ocres : une arène de corrida. Puis, au quatrième lever de rideau, une femme habillée de noir prend sa place. Elle ne quittera presque plus la scène.
À travers l’unique présence de la performeuse, se distinguent pourtant deux figures. Angélica, d’abord, dont la souffrance, la colère, le dégout, la cruauté même, sautent à la figure des spectateur.ice.s. Celleux-ci ne sont pas épargné.e.s : elle expose ses sentiments avec une superbe tirant parfois vers le glauque ou le trash. Dans une longue première partie, elle s’entaille les genoux et les mains. Sur la chanson Asingara de Las Grecas, elle s’enivre du vin posé à côté d’elle comme du sang qui coule de ses blessures. D’autres moments continuent de jouer avec les limites du supportable et de l’indécent : des bébés portés tels des offrandes, un cadavre de vache qui descend du plafond – image qui n’est pas sans rappeler les compositions du peintre anglais Francis Bacon. Patrice le Rouzic, sportif belge amputé de la jambe et du bras droit, apparait lui aussi, sans prothèse. Une première fois, il est seul, au centre de la scène : ses membres estropiés sont recouverts d’un bandage. Ensuite, il semble former avec Angélica Liddell un duo tragique. Tels Yseult et Tristan réincarnés, leurs deux silhouettes évoquent la dimension sacrificielle de l’amour. Faisant face à la mort, celle-ci apparait comme la condition d’accès à l’Absolu.
Pourtant c’est bien cette recherche d’absolu – et son impossibilité – qui provoque la souffrance d’Angélica. La performance, en exposant cette souffrance, semble vouloir aussi mener une réelle réflexion sur l’art. Elle explore, à partir de ses propres paradoxes, la manière d’accéder à un art autonome et sans consensus ; un art qui toucherait, par-là même, au sacré. On retrouve ainsi une importante dimension christique, avec la reproduction de rituels et symboles religieux. En faisant référence à l’art de toréer, elle s’inscrit également dans une lignée d’écrivains – tels que le poète Federico García Lorca ou le philosophe Didi-Huberman – qui virent dans cette pratique un acte hautement spirituel. Ils rejoignent la performeuse dans sa recherche d’équilibriste, entre cet inexorable appel du vide et la nécessité de se maintenir dans l’arène (dans le cas de Juan Belmonte), sur scène (pour l’artiste) ou en vie (pour les autres).
À la figure de dominatrice sans scrupule s’oppose ensuite une autre Angélica Liddell, moins assurée, presque suppliante. Elle surgit lorsqu’apparaît face à elle un taureau empaillé. Celui-ci est alors divinisé, immobile et sombre. On peut y voir une figure masculine ou rédemptrice, à laquelle l’artiste, habillée en torero, se soumettrait. Toutefois, c’est dans le paradoxe que représente l’animal que se trouve pour elle le salut : mourir et donner la mort, comme deux mouvements d’un même geste, pour tenter d’atteindre le sublime – celui de la corrida, de l’amour et de l’art. De fait, Liddell danse devant et autour du taureau, caressant son pelage et s’accrochant à ses cornes. Mais dans un même temps, dans son rôle de torero, elle n’a d’autre choix que de l’abattre. Dans le même temps, les guitares de la musique de Los Marismeños, groupe de musique andalouse, retentissent. Les rythmes profonds, qui rappellent la musique flamenca, engagent les corps dans une pulsion vitale qui les déborde. Angélica Liddell démontre ainsi l’importance de la chair et des sensations qui la traversent.
Cet appel au corps ne semble cependant pas suffire à insuffler l’élan vital qui viendrait, par là même, toucher le public. Le spectacle laisse peu de place à l’identification. En effet, en écrivant sa douleur intime, Liddell ne semble pas parvenir à réveiller celle des autres. Si elle instaure clairement une distance entre elle et son public – notamment au cours d’un long monologue aux allures de pamphlet – on peut s’interroger sur sa volonté d’entrer tout de même en résonnance avec les spectateur·ice·s. Puisqu’au milieu des insultes qu’elle leur adresse, surgissent finalement les échos d’une solitude pesante dont seuls la mort et le théâtre semblent pouvoir la libérer. Peu d’options s’offrent alors à celles et ceux qui, tel·le·s des laissé·e·s pour compte, demeurent à l’écart de cette quête passionnelle : soit se réfugier dans une indifférence feinte ponctuée de rires gênés ; soit se détacher progressivement ce qui se déroule devant leurs yeux, pour regarder en elles·eux-mêmes. Et finalement, s’interroger, peut-être, sur la pertinence de se rendre au théâtre pour vivre une expérience douloureuse, brutale et, surtout, solitaire.