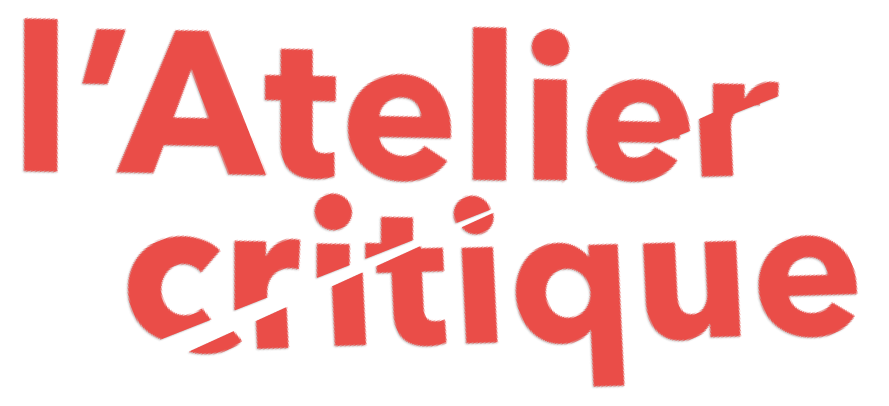Par Nathan Maggetti
Une critique sur le spectacle :
Pièce pour les vivant·e·x·s en temps d’extinction / Texte de Miranda Rose Hall / Mise en scène par Katie Mitchell / Théâtre de Vidy – Lausanne / du 25 septembre au 3 octobre 2021 / Plus d’infos.

Énergétiquement autosuffisant grâce aux efforts humains produits sur scène, le spectacle mis en scène par Katie Mitchell propose d’amoindrir, en plus de l’empreinte carbone des arts vivants, la tension entre individus et environnement, temps cosmique et temps humain, histoire du monde et histoires de chacun.e.s. Pour que les choses changent : en direction d’un théâtre éco-responsable et vers une harmonisation des dynamiques environnementales et communautaires. En résulte un spectacle aussi drôle qu’anxiogène, aux ambitions tout à la fois intimistes et universalistes.
La lumière, ce sont ces deux personnes, sur les chaises à droite la scène, qui s’en chargent. Le son, celles qui sont assises à gauche. Aux yeux de toutes et tous. Aux yeux de toutes et tous également, deux cyclistes pédalent sur place, fournissant l’énergie nécessaire au spectacle, dont la quantité en Watts s’affiche sur les écrans derrière eux. Plus visibles encore, ces deux-là, du fait des bandes lumineuses scotchées au sol autour de leurs vélos. À leur tressautant éclairage s’ajoute celui qui est dirigé sur la comédienne qu’ils encadrent, Safi Martin Yé. Dans ce décor qui ne change que peu, et dont les variations ne trahissent ni le minimalisme ni la transparence du dispositif scénique, cette dernière campe une dramaturge qui s’improvise conférencière-conteuse pour pallier l’annulation de dernière minute du spectacle prévu. Le thème de cette extrême mise en abyme ? Le même que celui du spectacle prétendument remplacé : la sixième extinction de masse, la nôtre, human made. La conférencière entame le récit de l’histoire de la Terre depuis son origine, l’entrecoupant d’anecdotes personnelles et d’interventions de son audience.. Vulgarisation scientifique et souvenirs d’enfance se mélangent ainsi dans le discours au ton faisant alterner léger et sérieux jusqu’à les amalgamer. Avant que n’entre en scène le motif de l’extinction de masse actuelle, et avec elle le pathos de circonstance ; entre célébration des vies vécues et déploration de celles qui sont sacrifiées, quel requiem pour l’humanité ?
Face aux enjeux climatiques contemporains, cette représentation poursuit un double but. Tout d’abord, elle entend être – et se montre – écoresponsable. L’ambition d’autarcie énergétique du spectacle affichée sur scène en dépasse le seul cadre : c’est depuis Londres, par visioconférence, que Katie Mitchell a organisé la mise en scène du monologue de Miranda Rose Hall. Par ailleurs, voué à se déplacer dans d’autres villes, le spectacle le fera seul avec son script : équipes techniques et actrices locales seront mobilisées sur les divers lieux de représentation. Ces choix s’inscrivent dans la lignée que proposent Jérôme Bel, Katie Mitchell justement, et le théâtre de Vidy, avec leur projet Sustainable Theater ?, qui interroge les possibilités qu’ont les arts vivants de… survivre éthiquement en contexte de crise climatique.
Mais le spectacle ne se cantonne pas à ce seul idéal écologique. Il se veut aussi écologiste, c’est-à-dire agent d’une mutation sur les pensées et comportements. Et cela, en s’attaquant à l’apparente incompatibilité de deux types d’histoires, celle du monde et celles de chacun.e.s ; parce que c’est dans l’inertie des vies particulières que se noie la prise en compte de la crise climatique, parce que trop concentré.e.s sur nos petits destins, on en oublie si souvent celui, grand et dramatique, de l’humanité. Comment, alors, conjuguer le temps cosmique, démesurément abstrait, avec celui, tangible et humain, de nos quotidiens et de nos vies ? La représentation tente de le faire en brisant le plus possible les hiérarchies et nivellements, pour rendre à la nature, dans nos perceptions, son unité et son homogénéité. À cet effet, sans doute, sont brouillées les frontières entre fiction et réalité : la conférencière, personnage fictif, s’adresse à un public bien réel, qui est appelé à prendre part activement à l’expérience. On comprend de la même façon la présence ostensible des régisseur.euse.s et des cyclistes, constants rappels visuels et sonores du temps externe dans lequel s’inscrit le temps interne et individuel. En parfaite cohérence et adéquation avec cette forme, le fond du discours est lui aussi axé sur cette abolition des tensions entre particulier et général. L’enchevêtrement d’une histoire de longue durée et de souvenirs humains se positionne en porte-à-faux avec un discours scientifique sérieux et par trop distant, que les membres du public, préoccupés par leurs tracas et intérêts quotidiens, ne pourraient assimiler ni conscientiser. C’est là que réside la force du théâtre, et plus largement des arts vivants : aptes, comme toute fiction, à proposer une configuration temporelle nouvelle (parce qu’affranchis des contraintes d’un discours non-fictionnel), ils sont les plus à même d’en reproduire le déploiement dans le monde réel, grâce à l’évidente synchronie entre les durées de l’œuvre et de la représentation.
La Pièce pour les vivant.e.x.s en temps d’extinction ne résout pas la tension entre temps cosmique et temps humain ; on ne saurait lui en tenir rigueur. Dans son questionnement finement rythmé persistent encore quelques obstacles à l’immersion spectatorielle, surmontés en idée seulement par la proposition participative, somme toute timide, et l’apparition finale d’un chœur, dont le potentiel fédérateur est sapé par le positionnement malencontreux face (et comme en opposition) au public. Dans le discours, la glorification du vivre ensemble empêche tout matérialisme historique, et par là reconduit peut-être plus qu’elle n’exorcise, dans le contexte d’un capitalisme triomphant, le malaise entre individu et environnement. En effet, comme le terreau socio-économique de l’extinction de masse actuelle n’est pas intégré au propos, ou transversalement seulement, on imagine difficilement les structures actuelles de nos sociétés concorder avec le partage presque insouciant d’expériences communautaires. Un mal pour un bien, sans doute, puisque notre réflexion s’en trouve stimulée. Il n’empêche qu’au son des trompettes de l’apocalypse, on ne sait toujours pas sur quel pied danser.