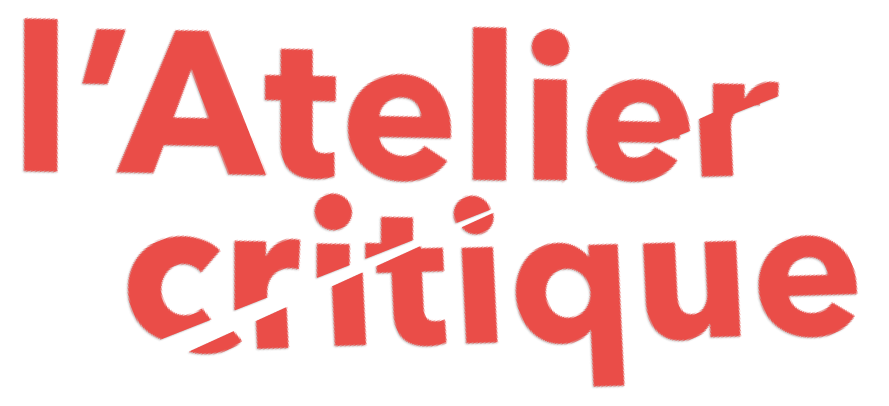Par Angèle Arnaud (étudiante à La Manufacture)
Une critique sur la captation du spectacle :
Ne plus rien dire / Texte et mise en scène de Joël Maillard / Captation vidéo : Alexandre Morel, Gwennaël Bolomey. Disponible sur le site de la compagnie SNAUT, URL : https://www.snaut.ch/ne-plus-rien-dire/ ou sur Viméo, URL : https://vimeo.com/117405187

Après Rien voir, pièce dans le noir pour deux spectateurs, et avant Pas grand-chose plutôt que rien, une accumulation de pas-tout-à-fait rien, Ne plus rien dire, « monologue pour un cercle de parole », s’inscrit lui aussi dans un projet plus vaste : le Cycle des rien. Créé en 2012 dans la salle de l’ancien Cinéma Eldorado à Lausanne, le spectacle fut repris en 2014, entre autres, à La Chaux-de-Fonds au Centre de culture ABC (Temple Allemand) ; c’est là, le 14 novembre, qu’une représentation fut filmée.
Entre les murs décrépis du Temple Allemand, sur le parquet en bois, on entend claquer les talons, les chaises qui s’entrechoquent, le brouhaha habituel d’un début du spectacle. Les spectateurs sont assis en cercle, inscrits au cœur du dispositif scénique. Installée sur l’une des chaises, une femme (Joëlle Fontannaz) prend la parole pour présenter son « projet » ; elle permet au public de comprendre qu’il forme un cercle de parole où chacun est invité à raconter l’histoire d’un « inachèvement ». La femme tire d’un grand cabas en plastique une boîte en fer dont elle fait sauter le couvercle maladroitement. La boîte rappelle les boîtes à biscuits de l’artiste plasticien Christian Boltanski, qui disait, à propos de son œuvre Les archives (1965-1988), « garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés, de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été dit autour de nous ». Ici, il s’agit des archives, (une cassette audio, des cartes postales, des manuscrits, des dessins) et des souvenirs partagés avec un autre personnage (« il »). Qui est « il » ? Un homme qui a décidé de quitter le monde. Pas de manière brutale en se donnant la mort, mais lentement en « dégradant » petit à petit les liens qui l’unissent au monde et aux autres. Cesser de parler fait partie de ce processus.
Deux personnages – « il » le muet, prétendument absent, et « elle », la narratrice qui l’a connu – réduits à des pronoms, comme chez Nathalie Sarraute ou Jon Fosse, comme chez Samuel Beckett surtout dont Joël Maillard est un admirateur inconditionnel. « Elle », narratrice du néant, vient ici pour dire celui qui n’a plus de voix, pour témoigner et essayer de donner sens à son entreprise. Éclairé par une douche de lumière, « il » (Jean-Nicolas Dafflon) apparaît lentement au milieu du spectacle ; il était assis là, dans le cercle, depuis le début. La femme porte la seule voix du texte mais elle n’est pas la seule en scène puisqu’elle est accompagnée par ce « il » muet, mais aussi par la technique scénique. À plusieurs reprises, le mutisme prend en effet la forme d’une musique, d’une amplification sonore, d’une variation d’éclairage. L’homme n’a plus de voix mais il a un corps, mis en lumières, en sons, en images, en écritures et en objets (grâce aux contributions de Sarah André, Christian Bovey, Chiara Petrini et Vincent Deblüe).
Durant cette pièce sans dialogue, le drama au sens aristotélicien est absent, ou au moins suspendu. Certes, il y a le projet de cet homme, mais rien ne se réalise. À défaut de péripéties ou d’éléments perturbateurs, le dispositif scénique agit comme une lentille grossissante : l’intime prend de l’importance au sortir des boîtes de Pandore. L’histoire portée par la narratrice est faite d’une série de petites fables ou d’exercices de disparition : instructions, actions, scénarios, happenings qui évoquent les avant-gardes (dada, le surréalisme, Fluxus…). Au fil des documents qu’elle puise dans son sac, la comédienne captive peu à peu le cercle de parole. Elle joue avec la distance réduite qui la sépare de ses voisins, fait des pauses, plonge son regard dans les yeux d’un interlocuteur de hasard.
Voilà que l’homme muet se lève et commence à disposer le contenu des boîtes dans l’espace. Les fragments d’un récit discontinu entrent ainsi dans une composition chaque soir différente (comme en témoignent les images du générique de fin de la captation). C’est finalement une installation, entre art contemporain et art brut, qui se crée dans l’espace délimité par le cercle de parole ; une carte mentale que l’homme muet construit et partage en direct et dans laquelle les spectateurs n’hésiteront pas à vagabonder, une fois les applaudissements terminés. On peut y voir aussi le labyrinthe mental de Joël Maillard lui-même – assis sur l’une des chaises – et la mise en scène de sa propre recherche. Une recherche du rien par le rien, de l’art par le petit, du théâtre par le vide.
Malgré la dernière vision donnée au spectateur, celle d’un effondrement des murs qui l’entourent, ce n’est pas un « message » ou une « prophétie » que Joël Maillard cherche à imposer. Il propose de déplacer le regard du spectateur, de lui donner un autre point de vue sur la vie et surtout sur le théâtre. Refusant le spectaculaire au sens de ce qui est grandiose, mais choisissant de transmettre une histoire qui permet moins de comprendre, que de prendre avec soi, voire de prendre pour soi. Car finalement, c’est un récit sans fin qui est donné à voir puisque « c’est jamais fini, il faut toujours recommencer à chaque minute tu dois continuer à ne plus rien dire et plus le temps passe plus la parole menace ». Une occasion de s’observer, de rêver et de se questionner sur son propre silence de spectateur.