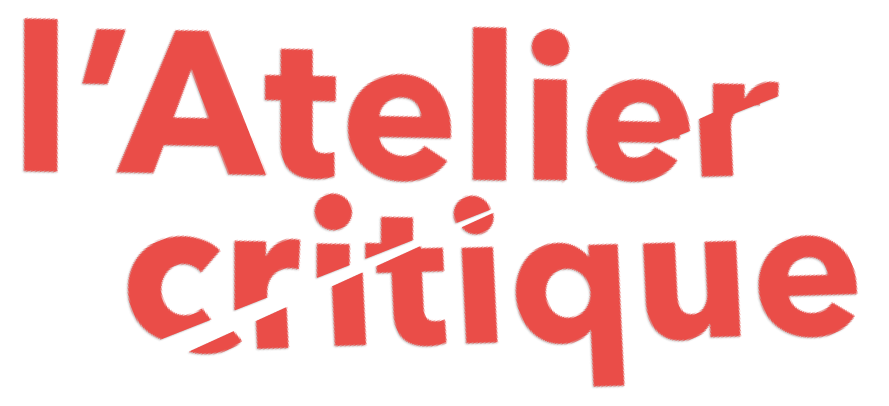Une critique sur le spectacle:
La Dernière Bande / D’après Samuel Beckett / Avec Omar Porras / Mise en scène de Dan Jemmett / TKM / du 14 novembre au 3 décembre 2017 / Plus d’infos

Dans La Dernière Bande, Omar Porras prête son théâtre et son corps à Dan Jemmett pour explorer la confrontation d’un un vieil homme avec lui-même. Une mise en scène qui démultiplie les jeux d’échos et de rythme, jusqu’à, parfois, nous perdre.
Les lumières se rallument, les applaudissements retentissent et Krapp nous tourne le dos. Il salue la foule peinte sur le mur du fond, dans l’encadrement des rideaux de velours. L’image est belle, évocatrice. Pendant tout le temps qu’ont duré le spectacle et les grommellements du personnage, nous, le public, étions en coulisses. Avec lui, dans son intimité d’homme en fin de vie écoutant des bribes de mémoire capturées sur des bobines, en fin de vie elles aussi. « Bobine ». Ce mot lui plaisait. Il le mastiquait et le susurrait, il se le répétait comme il les réécoutait. Seul avec son obscurité et son enregistreur, dans la lumière diffuse de son plafonnier, il mangeait des bananes et consignait ses souvenirs, comme chaque année depuis des lustres…
Rembobinage. Comme chaque année, Krapp raconte les détails banals de ses derniers mois : « Fanny est venue une ou deux fois », « me suis crevé les yeux à lire Effie », « été aux Vêpres » … Aujourd’hui, il choisit de remonter plus loin encore et d’écouter les banalités d’un ancien lui-même, du Krapp de ses trente-neuf ans. Ce Krapp-là avait la voix plus sûre, et pourtant si semblable. Mais à l’époque, Krapp sortait et rencontrait des femmes. Une femme, surtout, avec laquelle il avait dérivé nu sur une barque, goûtant aux caresses de ses mains et du soleil. Il n’en a pas profité, pas assez ; le jeune Krapp broyait du noir. « Difficile de croire que j’aie jamais été aussi con ! » s’exaspère le vieux Krapp. En réécoutant ses souvenirs, le vieillard regrette ses trente-neuf ans, ou plutôt, il regrette de ne pas les avoir vécus, toujours déjà tourné vers la mémoire qu’il en garderait, à l’ombre de son magnétophone. Mais n’est-ce pas dans cet éternel retour sur son ancien lui-même qu’a toujours résidé sa seule raison d’exister ? La vie, au fond, est-ce autre chose cela ? un perpétuel rembobinage ?
Krapp face à lui-même, donc c’est le jeu d’écho imaginé par Beckett. Et, comme pour lui répondre, Jemmett le répercute. Partout. Sur la scène, il y a une scène. Derrière le rideau, il y a un rideau. Face au public, un autre public. Peut-être pour nous rappeler une fois encore que le monde est un théâtre et que le jeu ne s’arrête jamais, pas même pour soi-même. Alors on est pris, embarqués dans cet univers de la répétition où tout est double, triple, quadruple : si la petite figure blanche et courbée s’avance de sa démarche en saccades pour ouvrir un tiroir et en tirer une banane, elle y retournera, c’est prévisible, pour en extraire une seconde. Cette prévisibilité fait sourire. Omar Porras sait bien la manier, avec sa parfaite pantomime de clown triste. Et pourtant, le silence n’est pas de plomb. Dans la pénombre de la salle, on entend des chuchotements. Il faut dire que le texte de Beckett est exigeant : chaque soupir y est précisé, chaque déplacement consigné, chaque peau de banane décrite. Les didascalies, en somme, composent une partition polyphonique et gestuelle que Porras, sous la direction de Jemmett, suit à la lettre. Mais dans cette œuvre intransigeante dont chaque syllabe est pesée et soupesée, les arythmies se repèrent et les dissonances s’entendent. Et ce soir-là, peut-être que le rythme n’y était pas.