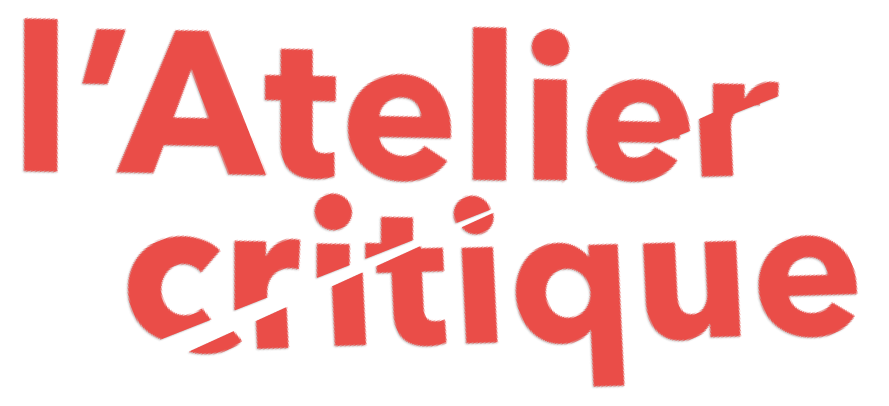Un Tramway nommé désir / de Tennessee Williams / mise en scène Zoé Reverdin / du 23 juin au 11 juillet 2015 / Théâtre de l’Orangerie / plus d’infos

La production genevoise d’Un tramway nommé Désir, présentée au théâtre de l’Orangerie cet été, fait le pari de refuser l’identification totale entre comédiens et personnages. Sous la direction de Zoé Reverdin, les acteurs prennent plaisir à révéler la primauté de leur jeu sur les personnages qu’ils incarnent, avant d’être emportés par cette tragédie domestique, grâce à eux sublimée.
L’histoire est connue: Blanche, aînée ruinée d’une bonne famille du Mississipi, vient s’installer dans l’humble masure néo-orléanaise que possède Stanley, son beau-frère rustre, alcoolique et violent, en particulier avec sa femme Stella, cadette réaliste mais soumise de l’arrivante. La convaincante Marie Druc, qui interprète cette dernière, donne rapidement le ton: la diction en accéléré, l’absence d’implication émotionnelle et le sourire en coin indiquent la distance initiale qui est prise avec le texte. Anna Pieri, qui joue la sœur, n’est pas en reste et entre dans le (non-)jeu, initiant un dialogue qui met paradoxalement en valeur les répliques par le fait de ne pas s’y attarder, l’attention étant d’autant plus mobilisée. De même, Valentin Rossier, un Stanley beaufissime – une réussite, donc -, prend plaisir à caricaturer son personnage lors de sa première apparition comme pour en faire ressortir la facticité. Le résultat est humoristique, dans un premier temps, le spectateur étant surpris par le procédé. Et l’ironie, perpétuelle remise en question du propos par le détachement vis-à-vis du texte, est d’abord bon enfant.
Puis la fiction semble rattraper et les comédiens et les personnages: l’histoire qui est racontée n’est pas drôle, et ne finira pas bien. L’illusion se crée malgré tout, et d’autant plus qu’elle n’est pas imposée. Le parcours de Blanche n’est d’ailleurs pas bien éloigné de celui du spectateur: on la voit mettre en place un réseau de mensonges qui altèrent la réalité en la rendant supportable, de même que dans l’obscurité le public est satisfait que ce qu’on lui présente ne soit pas vrai. Les mots sont le vernis qui adoucit le réel, lui donne une teinte éthérée. Ainsi, lorsque Mitch, “l’amoureux” de Blanche, tente de l’embrasser contre son gré, leur échange reste convenu, masquant la violence de l’acte; le décalage est également important entre les coups que reçoit Blanche et le récit qu’elle en fait le lendemain, les marques sur son visage contredisant les mots. Les déferlements de violence de Stanley sont mis en scène de manière très brève, dans la pénombre, déréalisés. On nie la réalité pour tenter de s’en défaire. Les personnages ont évolué, les caricatures amusantes du début cèdent la place à une version inquiétante de leurs masques, sans renoncer complètement à cette distance vis-à-vis du texte: l’ironie s’est faite mortifère. Il y a un bourreau et il y a une victime : Stanley, lucide et terre-à-terre, jouissant de sa médiocrité, détruira Blanche, rêveuse mais menteuse, tentant d’échapper à son insignifiance. Il y a une morale : la fiction est toujours abolie par le réel. La réussite de la mise en scène tient dans le fait d’avoir exacerbé l’un pour rendre compte de l’autre, en un subtil jeu méta-théâtral. « Je ne dis pas la vérité, je dis ce que devrait être la vérité », affirme Blanche, résumant le travail de dramaturge. A l’Orangerie, pourtant, on a cru voir quelque chose comme de la vérité.