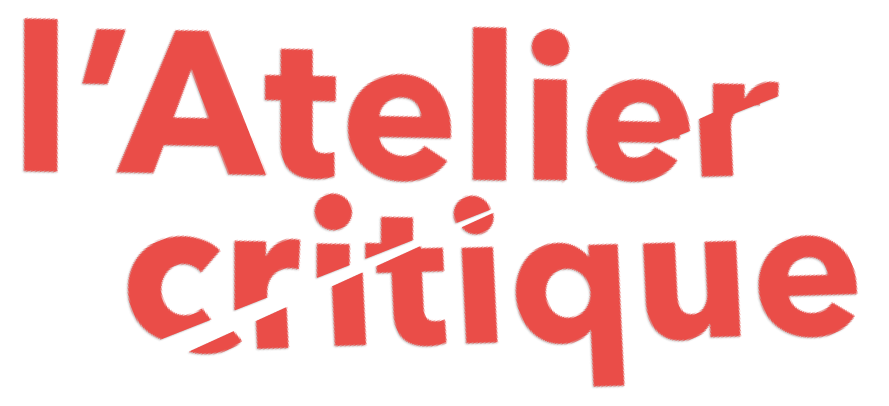Par Jade Lambelet
Une critique sur le spectacle :
Maelström / Texte de Fabrice Melquiot / Mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe / Théâtre Am Stram Gram / du 29 novembre au 2 décembre 2018 / Plus d’infos

Premier volet du triptyque de Pascale Daniel-Lacombe, Maelström esquisse un tableau sur l’adolescence encadré par une réflexion plus globale sur notre rapport au temps et au monde. Seule sur le quai d’une gare, Vera, à tout juste quatorze ans, crie au monde les tempêtes et les marées qui habitent son cœur. Atteinte de surdité, la jeune fille se décharge dans un monologue dramatique des sentiments de solitude, d’incompréhension et de douleur qui accompagnent son handicap et sa première rupture amoureuse.
Depuis plusieurs années, La Compagnie du Théâtre du Rivage dirigée par Pascale Daniel-Lacombe concentre ses activités sur les passages entre les différents âges et stades de la vie humaine. Le projet artistique, baptisé Dasein (Être là) d’après le concept heideggérien, se propose d’interroger la façon dont, à des âges différents, nous envisageons la temporalité passée, présente et future de notre existence. Partant d’une collecte de témoignages divers sur la question du temps, la metteure en scène se tourne vers l’auteur dramatique Fabrice Melquiot à qui elle commande le texte de son spectacle. Ce dernier isole sur scène une jeune adolescente en proie aux affres de sa condition familiale, amoureuse et corporelle. Dans sa mise en scène, Pascale Daniel-Lacombe propose à son public une expérience auditive qui se veut immersive et complète par le biais de casques retranscrivant le monologue de l’actrice sur un fond sonore et musical.
La connivence avec le spectateur est cherchée dès son arrivée dans la salle par une diffusion sonore reproduisant le décor urbain d’une gare. Le vacarme des klaxons des automobiles et du passage des trains brusque l’oreille du public qui prend place dans les gradins. Puis un signal lumineux nous invite à porter notre casque au travers duquel les paroles de Vera (interprétée par Marion Lambert) nous sont insufflées sans distance, comme celles d’un monologue intérieur. Ainsi, le dispositif auditif a pour effet de renforcer l’identification au personnage. Sur scène, nous retrouvons le décor d’un vestibule de gare dont la structure mobile – par le biais de rails qui façonnent le décor autant qu’ils soutiennent son articulation – glisse pour se transformer en d’autres lieux dans lesquels déambule la jeune fille. Bien que cette prison de verre qui l’enferme soit subtilement imaginée, elle ne circonscrit pas complètement les mouvements de Vera dans l’espace : le dispositif, parce qu’il manque de systématicité, s’apparente plutôt à un subterfuge attrayant sans soutenir véritablement l’architecture discursive de la pièce. Le choix des musiques qui tapissent en fond les différentes problématiques soulevées par le monologue de Vera (piano lent et dramatique pour les moments de tristesse, vrombissement grave et inquiétant pour l’évocation des crimes nazis, rock’n’roll éclatant et enjoué pour les pulsions de rébellion) parachève, par sa redondance, le basculement de celui-ci vers un tragique plat, vecteur de lourds clichés.
Dans son exploration de la temporalité, la pièce esquisse une multitude de trames narratives : le présent brûlant de la rupture amoureuse ; la permanence des souffrances liées à la situation de handicap et à la structure familiale brisée en l’absence cruelle du père ; l’effroi que suscite un futur menacé par le terrorisme ou un passé meurtri par les crimes de deux guerres. Toutefois, ces intrigues qui ne sont reliées que lâchement entre elles se perdent dans un écart entre des échelles individuelles et collectives et leurs potentialités ne sont exploitées que maigrement là où elles auraient gagné à l’être pleinement mais en nombre restreint. On comprend mal si le désespoir et la rage qu’exprime Vera sont les résultats d’un sentiment d’incompréhension et de solitude adolescent – auquel cas la pièce véhiculerait des lieux communs à propos de l’adolescence en la figurant comme une expérience pesante et languissante – ou si ces souffrances sont provoquées par sa surdité. Dans ce dernier cas, cet unique éclairage sur la situation de handicap pourrait être jugé réducteur. Quant à la problématique historique des victimes des guerres et de l’empathie profonde de la jeune fille à leur égard, elle est malheureusement noyée dans des larmoiements et des gémissements vulgaires à la lecture d’une lettre d’un poilu.
Dès lors, quel est le message que veut faire passer Maelström au jeune public auquel le spectacle s’adresse ? Certes, l’adolescence est un moment de lourds questionnements existentiels mais elle n’est pas que drame et désespoir (ce que la pièce et le spectacle semblent dire tout du long et par le biais des images de la femme à l’hôpital et de Vera en équilibre sur les rails du train) pas plus que ne devrait l’être d’ailleurs un handicap. Si l’impulsion et les réflexions à l’origine de la création annonçaient une expérience riche et éclectique, Maelström passe à côté de la force et de la grandeur poétique de son sujet en abandonnant sa dimension tragique dans un pathétique stéréotypé.