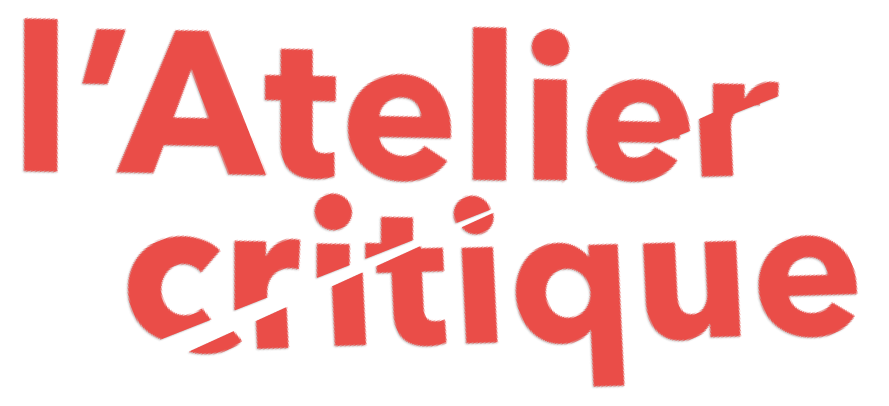Par Maxime Hoffmann
Une critique sur le spectacle :
Automne-Hiver / D’après les textes de Charles Baudelaire et de Jean Racine / Mise en scène et de Yves-Noël Genod / L’Arsenic / du 1 au 4 novembre 2018 / Plus d’infos

Cette douce saison où chaque jour décline offre une occasion d’invoquer Baudelaire. C’est le noir Automne qui précède l’Hiver, temps où la sève redescend jusqu’au Racine. La poésie était à l’honneur à l’Arsenic ce soir jeudi 1er novembre. Yves-Noël Genod y présentait son diptyque Automne-Hiver, dont chacune des parties est respectivement inspirée de l’œuvre de Charles Baudelaire et de Jean Racine.
C’est logiquement par Automne que débute la soirée. Au centre de la salle sont militairement alignées un peu moins d’une centaine de chaises. Deux rangées faisant face à l’ouest et deux autres vers l’est, elles se tournent le dos. Faisant front aux spectateurs, quatre haut-parleurs de chaque côté trônent sur des pieds solides qui les situent à la hauteur du visage. Mais est-il possible de parler de spectateurs alors que l’expérience d’Automne se vit plongé dans l’obscurité totale ? Le poème l’avait prédit : « Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres » (Chant d’automne). La salle se révèle être un sarcophage dans lequel aucune lumière n’entre. Une fois les projecteurs éteints, une voix se fait entendre et, comme promis, elle lit des poèmes de Baudelaire.
La voix est celle d’Yves-Noël Genod. D’un timbre changeant et rauque, elle résonne avec emphase et ampleur. La totale obscurité, cette pleine ombre, dépossède les yeux de leur fonction ; bien qu’ouverts, ils semblent fermés, ils ne distinguent rien. Les sons deviennent la seule perception des sens. Les poèmes se parent d’une nouvelle signification, ils s’incarnent sans l’intermédiaire de la lecture, uniquement « focalisés » sur l’oralité, sur l’arrangement des consonnes et des voyelles. Les images se manifestent plus clairement, ce sont des représentations entièrement imaginaires. Ce régime dure environ deux heures. C’est long, deux heures. On pourrait croire qu’il y a le temps de s’ennuyer. Bien qu’emplies d’art et de finesse, les Fleurs du Mal pourraient se faner à force d’être assenées aux oreilles du public. Cette appréhension s’accroît d’autant plus lorsque L’Horloge sonne :
Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !
Deux heures, c’est long, et ce poème nous rappelle la valeur de chaque seconde. Pourtant, Automne n’ennuie pas. Cela est dû à un travail sur la variation. En effet, la voix laisse entendre des ratés : le mot juste était « bosquet » et c’est « bouquet » qui est venu, alors elle recommence le vers. Ce naturel de la lecture entretient l’attention : parfois la surprise engendrée par l’erreur réveille aussi bien les spectateurs plongés dans la poésie que ceux qui ont sombré dans le sommeil. De plus, le dispositif audio projette la voix à de multiples endroits de la salle, renforçant l’impression de hasard. L’artifice apporte, lui aussi, une part d’inattendu qui participe beaucoup au plaisir. Des bruits, des échos, des violons et un piano, servent d’intermède entre les poèmes. Plus surprenant, des silhouettes à l’allure de spectres apparaissent. Elles errent. Ce sont des corps nus enduits de phosphorescence qui vagabondent autour du public. La sensualité du poème semble être incarnée par ces ombres.
Puis, les deux heures sont passées. Pour certains, l’aventure est finie et pour d’autres, elle reprendra après trente minutes.
Le temps est venu de côtoyer l’Hiver. De retour dans la salle, le public voit la disposition des nombreuses chaises changée. Elles longent maintenant les murs et libèrent tout l’espace. Assis sur le sol, un homme attend dans un grand manteau qui le calfeutre et un autre sert du vin mousseux à qui en veut. Ce contraste entre précarité et prodigalité restera un moment la seule action. Soudain, une silhouette féminine entre en scène et les deux hommes se déportent à deux angles opposés de la salle. Elle est vêtue d’une longue robe dorée qui reflète par éclats des rayons de lumière. Après la nuit d’Automne, on songe à ce vers même de Racine : « Mes yeux sont éblouis du jour que je revois » (Phèdre, v.155). Cette silhouette est en réalité celle d’Yves-Noël Genod. Il s’apprête à jouer Phèdre comme un monologue.
En effet, aidé d’un souffleur, il monopolise la parole pour donner vie aux vers de Racine. Comme lors d’Automne, le hasard de l’erreur tient en haleine et parfois, le comédien s’arrête. Il en profite même pour partager des anecdotes. Là encore, ce sont deux heures de poésie, ressenties comme plus longues que celles d’Automne, car moins immersives. L’art est ici dans la performance, ainsi que dans la relation entre le comédien et le public, alors qu’Automne valorisait un repli sur soi et l’imaginaire. Le défi est néanmoins beau.
Ces deux expériences invoquent avec naturel deux des plus grands poètes de la langue française. Malgré le fait que ces deux spectres hantent le panthéon littéraire d’une aura de majesté, Yves-Noël Genod nous rappelle le plus essentiel de leurs poésies, c’est-à-dire l’émotion. Le premier est mélancolique, parfois froid, souvent touchant et le second clair et brillant. Ils évoquent la nuit puis le jour, valorisent les oreilles puis les yeux. Un diptyque oxymorique pour l’amour de la poésie.