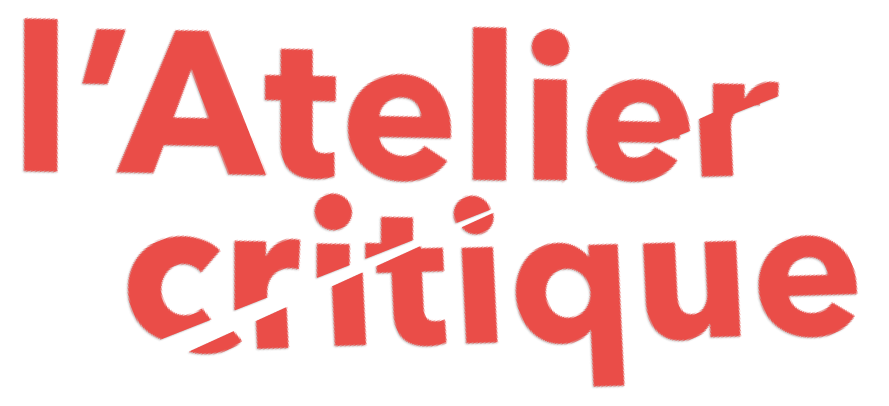Par Amalia Dévaud
Une critique sur le spectacle :
La Ménagerie de verre / De Tennessee Williams / Mise en scène de Daniel Jeanneteau / Théâtre Kléber-Méleau / du 17 au 22 avril 2018 / Plus d’infos

Ménagerie, nom féminin : lieu où sont réunis des animaux dangereux, exotiques, ou rares destinés à être montrés au public. Le huis-clos de Tennessee Williams met en scène le mal de vivre d’une famille modeste, dans le Missouri des années 1930. Au centre de cette cage métaphorique se trouve Amanda, une mère acariâtre qui règne tel un paon flamboyant sur son fils Tom – casoar craintif ne sachant pas voler – et sur sa fille Laura, oisillon à la patte infirme. Au TKM, Daniel Jeanneteau montre la violence d’un microcosme familial où rien ne rentre ni ne sort ; où l’impuissance se cristallise, donnant aux personnages des allures de statues de verre manquant se briser à chaque instant.
« Je vous présente la vérité sous l’apparence plaisante de l’illusion » annonce Tom au début du spectacle. Son statut de narrateur montre d’emblée la double temporalité de la pièce : d’une part celle du présent de la représentation, qui évoque le devoir de mémoire de Tom envers sa sœur, Laura, laissée aux griffes de leur mère dans l’appartement de Saint-Louis ; d’autre part, les analepses, le déroulement de la fable se donnant à voir dans un temps révolu et à travers le prisme du souvenir.
Les souvenirs de Tom parviennent par vagues de conscience successives, dans un mouvement de flux et de reflux qui ne cesse de vider et de remplir l’espace scénique. La scénographie imaginée par Daniel Jeanneteau repose sur l’idée d’une conscience flottante, à la manière d’un « rêve éveillé ». Cette analogie avec le rêve lui avait initialement été suggérée par Satoshi Miyagi, directeur du Shizuoka Performing Arts Center de Tokyo, pour lequel il avait conçu ce spectacle en 2011. Travaillant depuis plusieurs années au Japon, Jeanneteau livre ici une mise en scène à la croisée des traditions orientales et occidentales : du Japon il emprunte certains accessoires et des jeux d’ombres, et de la France – plus particulièrement du metteur en scène Claude Régy – une esthétique de la lenteur et du jeu d’acteur éthéré, qui ôte tout réalisme psychologique au spectacle. En effet, le geste théâtral de Daniel Jeanneteau est plutôt celui d’« une invitation au voyage mental ».
La scène est parcellisée en trois espaces avec, au centre, une boîte composée de tentures transparentes et meublée d’une table et de deux chaises : il s’agit du centre névralgique de l’activité ménagère d’Amanda. Cette boîte est le lieu de la fable – celui de la mémoire – où s’exerce librement la violence maternelle. Les déplacements d’Amanda soulignent par ailleurs l’excessivité de son tempérament car elle se tient souvent au centre : centre des discussions, de la lumière. Et même lorsqu’elle sort de l’espace scénique, elle s’y inscrit de façon omniprésente en tant que voix off.
Autour du dispositif central de la boîte se trouve un espace vide : lieu de calme où se réfugie Tom pour échapper au giron maternel. À l’avant-scène, également délimitée par une tenture transparente, repose une sculpture de verre – symbole de la Ménagerie : c’est l’espace de Laura qui, par le prisme du verre, reflète non seulement la fragilité de la cellule familiale, mais aussi l’immobilisme inquiétant de sa vie personnelle.
La problématique principale des Wingfield est, semble-t-il, leur difficulté à distinguer la frontière entre rêve et réalité. Peut-être pour ne pas voir leurs solitudes respectives ? Et ainsi s’aveugler sur ce temps perdu contre la vie ? Toute la famille souffre de cette irrationnalité : Amanda reste enfermée dans ses souvenirs de jeune fille entourée de galants et projette sa vie dans celle de sa fille. Tom parle d’aventures mais passe ses soirées au cinéma tandis que Laura, en raison d’une infirmité à la jambe couplée d’une grande timidité, s’isole sans raison. L’écart entre le rêve et la réalité n’est jamais comblé et explique, sans doute, le sentiment d’impuissance qui traverse l’ensemble de la pièce et reflète l’incapacité de la famille à communiquer et à survivre au monde, ensemble.
À cette première distorsion du réel s’ajoute celle de l’inaction : la Ménagerie est silencieuse comme du verre et, même si Tom crie souvent, sa révolte reste inaudible. Le seul personnage qui y apporte de la chaleur est son meilleur ami, Jim O’Connor, qu’Amanda invite un soir pour lui présenter Laura. Par contraste, Jim est d’un tempérament jovial : sa vitalité et sa spontanéité nous réchauffent nous aussi, spectateurs tenus à l’immobilité alignée de nos sièges.
Jim et Laura. La promesse d’un envol pour la jeune fille. Peut-être y verra-t-elle le moment de déployer ses ailes et de quitter son animalerie inanimée pour vivre le plaisir de la chair, de l’échange avec ce jeune homme qui se dit « déçu mais pas découragé » par la vie. Le réalisme et la sensibilité du jeu de Solène Arbel (Laura) et de Quentin Bouissou (Jim) émeuvent par leurs maladresses et leurs silences, vestiges de notre première mémoire amoureuse. La chute semble toutefois certaine car a-t-on jamais vu l’illusion triompher sur la réalité ? C’est, semble-t-il, l’une des lectures proposées par Daniel Jeanneteau qui symbolise la défaite de cet amour naissant par le lever de la tenture transparente, juste avant l’arrivée de Jim à la Ménagerie. Si l’incursion du réel dans l’imaginaire permet de goûter à un ailleurs inattendu, à une illusion passagère, il en dévoile en même temps toutes les failles. L’absence de larmes de Laura et son cadeau d’adieu à Jim ne suggèrent-t-ils pas pourtant que ce qui traverse le verre finit par y laisser une trace ?