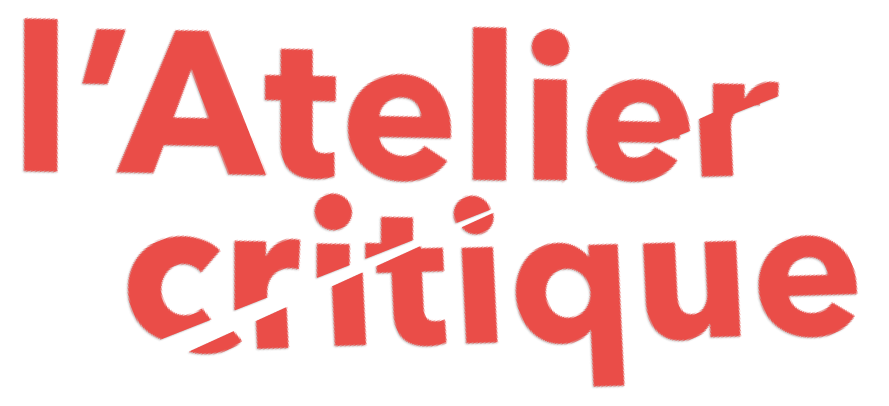Une critique sur le spectacle:
Guerrilla / Par la compagnie El Conde de Torrefiel / Théâtre de Vidy / du 8 au 9 décembre 2017 / Plus d’infos

A Vidy, Guerrilla donne à voir la guerre intérieure, confusément maîtrisée, qui caractérise les paix apparentes des démocraties européennes. Prenant la forme d’une politique-fiction, séparant le texte de l’image scénique, cette pièce dit les tensions entre l’Histoire et l’individu, entre l’individu et lui-même. Une originale et brillante incarnation théâtrale de la violence et de ses contradictions.
La guérilla est une guerre diffuse ; elle n’a pas de front localisé, elle est composée de petits groupes éparpillés. Ceux-ci se fondent parfois dans la population, agissent souvent là où l’on ne s’y attend pas. La guérilla suppose une absence de pics d’extrême violence : on la dit être une guerre de « faible intensité » ; surtout, elle fonctionne sur l’usure, sur une pression latente mais constante. Les groupes opposés ou alliés d’une guérilla ont l’animosité et la tension pour partage.
La Guerrilla du groupe El Conde de Torrefiel, est un spectacle en trois tableaux – une conférence, une séance de tai-chi, une rave – animés par quatre-vingts figurants de la région. Leur Guerilla est une nébuleuse en tension dont la dynamique se déploie en interne – dans les « esprits » – et que l’on ne saurait même verbaliser. Les acteurs ne parlent pas sur scène ; au-dessus d’eux, un texte est projeté, qui dit les pensées intimes et les récits de vie de cinq des figurants. Ce texte est issu d’un travail documentaire d’interviews. Il est aussi rythmé par l’insertion de discours fictionnels. Ces cinq personnes sont comme sorties de l’anonymat, démarquées de la foule. Pourtant, ils n’ont pas de prénom, seulement des initiales. Leur présence scénique s’inscrit dans une « zone de confort », ils évoluent dans un cadre sans apparente hostilité, prennent soin de leur santé dans un cours de tai-chi qui se déroule sereinement, sur fond blanc. Leurs pensées sont pourtant brûlantes de malaise civilisationnel. La scène et le texte sont en tension : ils rejouent la lente érosion d’une guérilla. Ils discutent de loin, mais mal, ils pratiquent le « téléphone arabe » : les messages se contredisent, parce que l’humain se contredit.
Ces récits individuels s’entrecroisent avec l’histoire de certaines violences fratricides du XXe siècle – Rwanda, Espagne, Cambodge -, et se construisent sur une politique-fiction qui projette le spectateur entre le 7 et le 9 décembre 2019 (soit deux ans après la date de la représentation à laquelle nous assistons, ce 8 décembre 2017, à Vidy), et qui, avec précision, décrit l’an 2023. Ce futur est violent, il est comme brodé sur le souvenir de 1939 ou de 2017. Guerrilla est transhistorique, les temporalités se fondent et se confondent : demain ressemble tant à hier qu’il paraît possible de se souvenir du futur ; les dialogues projetés sont pleins du pressentiment – presque assuré – de la catastrophe. « Qu’est-ce qu’on fait ici ? », dit l’une.
L’angoisse qui se diffuse dans le texte – par le retour des sujets graves qui y sont exhibés et des questions infusées de doutes – appelle à percevoir l’usure de l’humain par l’humain et de l’individu par lui-même comme la seule constante certaine ; comme le seul point névralgique de la pièce, le seul point fixe au sein de cette nébuleuse incendiaire qui abîme la frontière entre la singularité d’une histoire et l’histoire collective. Car à l’horreur des récits de guerre se juxtaposent des réflexions sur l’arachnophobie, l’économie, la possibilité de l’art ou de l’ennui – sur le drame quotidien. La guérilla se fait transindividuelle, elle semble être tout ce qui viole la sérénité intérieure ; il est peut-être même subversif d’oser réfléchir à la guérilla intime. La musique trahit ce fil rouge, qui part en discrets larsen au sein-même du cours de tai-chi. Elle se dépressurise finalement en une lourde techno assumée. « La guerre n’a jamais semblé plus pacifique. La paix n’a jamais semblé plus terrifiante. »
L’art même ne peut plus rien : il y est au mieux « une énorme fête ». La troisième partie ressemble à cela : une extension du domaine de la fête. Ne plus dire, danser. Corporaliser au lieu d’intellectualiser. Crier en soi, avoir mal aux oreilles. Et surtout se taire en transpirant. Et là : la foule tourne le dos au public. La foule fait unité, danse derrière un voile transparent qui aplanit la profondeur, contribue à effacer les individualités qui la constituent. Mais les textes inquiets et violents ne savent pas se taire. Quelques stroboscopes aveuglent, avant une fin brutale.
Guerrilla incarne un mouvement de l’individu au tout et du tout à l’individu. Le spectacle se construit sur une communication approximative mais sensible et juste entre les consciences, magnifiée finalement en une dialectique théâtrale efficace : du conflit initial entre la scène et le texte résulte un sentiment cathartique d’avoir pu épancher certaines de nos propres angoisses. Le constat lucide et maîtrisé d’un besoin commun de déborder, dans la confusion et la violence sonore, face à ces passés et ces futurs politiques, religieux, humains. Face à sa propre guérilla intérieure : les doutes que chacun partage, la violence d’Eros et de Tanathos, qui, du dehors, restent mal visibles.