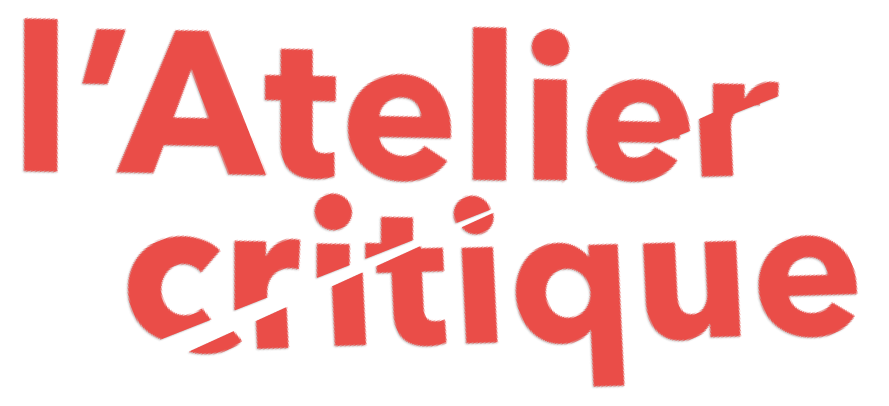Une critique sur le spectacle :
Le Direktør / D’après Lars von Trier (film) / Mise en scène d’Oscar Gómez Mata / Théâtre de Vidy / du 8 au 11 novembre 2017 / Plus d’infos

Adaptation vaudevillesque d’un film plus sombre qu’il n’y paraît au premier abord, Le Direktør d’Oscar Gómez Mata est une comédie qui s’efforce de penser l’absurdité d’une société où l’autorité de plus en plus invisible rend la servitude involontaire. Au-delà de son apparente légèreté, la pièce est un tour de force qui emboîte les niveaux de fiction et fait amèrement rire des rôles sociaux, affectifs et théâtraux. Un spectacle profondément intelligent.
Un acteur erre entre les rangs du public qui s’installe et m’interpelle : « Bonjour, je suis le directeur. – Vous êtes le directeur du théâtre ? – Ah non, je suis un acteur. – Un acteur de la pièce ? – Non, un acteur dans la pièce. » Vous suivez ? Non ? Ne vous en faites pas, après c’est pire. « Je suis un acteur qui joue le directeur dans la pièce, et là je répète mon texte. – Votre texte de la pièce ? – Non, mon texte dans la pièce » : bienvenue dans le théâtre d’Oscar Gómez Mata.
Mon interlocuteur, déjà dans son personnage, se révèlera être Kristoffer (David Gobet), un acteur au chômage récemment embauché par une petite entreprise d’informatique danoise pour jouer, effectivement, le rôle de son directeur. Ravn (Christian Geffroy Schlittler), le fondateur et directeur véritable, n’a jamais réussi à assumer sa fonction auprès de ses employés et prétexte depuis toujours l’existence d’un « directeur de tout » pour justifier ses décisions, notamment les plus impopulaires. La situation change lorsqu’il décide de vendre son entreprise à un acheteur islandais patibulaire qui exige de rencontrer le « vrai » directeur. Ainsi Kristoffer va-t-il devoir jouer au patron de PME et Ravn croiser les doigts pour que tout se passe comme prévu. Gómez Mata adapte ici une œuvre de la filmographie du déjà culte Lars von Trier et s’il reste, dans l’ensemble, fidèle au scénario d’origine, il en propose une version profondément transformée.
L’entreprise selon Mata est rétro, esthétiquement déglinguée, affichant l’élégance hispter d’une table au design contemporain entourée de chaises en plastique premier prix. D’emblée, on craint que le spectacle ne sacrifie quelque peu la profondeur de l’œuvre originale en faveur de sa propre photogénie. Le metteur en scène a voulu un jeu presque vaudevillesque, qui bien que porté par des acteurs exceptionnels, inquiète lui aussi quelque peu. La plupart des protagonistes se comportent en électrons libres, hurlent, lancent des meubles au hasard, se cognent sans raison dans le décor, trébuchent quand ils parlent, traversent le public en grommelant des phrases incompréhensibles ou des blagues potaches. Le comique tue dans l’œuf le réalisme des personnages, la vraisemblance de la représentation et rend souvent les quiproquos moins précis que dans le film de von Trier car les personnages ne semblent pas croire un seul instant à l’existence de tout cela. Un certain goût pour l’absurde, notamment lorsque Heidi (Camille Mermet) répète désespérément les répliques des autres, plonge le public dans un malaise assez drôle, mais évacue indéniablement le tragique des personnages. Evacué aussi le personnage de Kisser, ex-femme de Kristoffer, dont tout l’arc narratif est supprimé, et qui permettait pourtant au film de donner une épaisseur et une vraisemblance aux dilemmes moraux de son personnage principal. Le moindre dialogue cohérent devient assez vite impossible, un fragment d’organisation auquel on s’accroche, et qu’on abandonne vite lorsqu’un exhibitionniste vêtu du célèbre bonnet noir des Welsh Gards entre en scène, montre son sexe au mur du fond et repart comme il était arrivé. Bon. L’adaptation ne risque-t-elle pas de transformer cette « comédie sans importance », selon le mot ironique de la voix off qui conte le film, en comédie véritablement sans importance ? L’un des coups de génie de von Trier était de rendre possible un métathéâtre à l’intérieur de l’image cinématographique, effet qui, une fois adapté sur scène, risque de perdre un peu de sa pertinence et de son originalité. D’emblée ce jeu métaleptique avec la frontière tracée sur le sol de la scène peut laisser craindre un certain déjà-vu, ou du moins que la transposition ne fasse perdre de son impact au procédé.
Mais, passées ces premières inquiétudes, on comprend que l’abandon de la vraisemblance fabrique chez Gómez Mata un monde en roue libre dans lequel la comédie se dépasse elle-même et, finalement, discute véritablement l’autorité (presque l’autoritarisme) du réel. Devons-nous assumer les actions de ce qui n’est qu’un rôle que nous jouons ? Quelle autorité a l’invisible sur le visible ? Qui est le sous-fifre, qui est le directeur ? « On s’en bat les couilles ! » répondrait la sonnerie de l’iPhone de Gorm (Vincent Fontannaz). De ce point de vue, la pièce s’avère par moments plus subtile que le film originel. Gomez Mata a l’art de déranger jusqu’au bout le rationnel, d’extirper du délétère une stabilité étrange et de mettre véritablement en jeu notre liberté dans la fiction.
D’abord, par sa conscience aiguë de l’histoire du théâtre et des travaux de ses pairs, investie dans un medley impressionnant de références (le personnage pirandellien, le catastrophisme de Spregelburg, le goût d’Ibsen pour la provocation) qui atteint sans doute son paroxysme dans une pique sublime, lorsque Kristoffer déclare « Pour moi l’Idée, c’est Dieu. Même si l’idée vient de Macaigne » (la réplique originale, chez von Trier, étant « Pour moi l’Idée c’est Dieu. Même si l’idée vient de Hitler »).
Puis, par l’insistance de la mise en scène sur l’au-delà des choses. Le maitre spirituel de Kristoffer, un dramaturge italien fictif répondant au nom de Gambini, insiste sur l’importance de la « pause », arguant, par la voix de son disciple, que c’est davantage ce qu’on ne voit pas que ce qu’on voit qui fait le sens de la pièce. Et l’on retrouve effectivement, au fil de la décousure du drame, des moments très codifiés – un grand carré vert s’allume en Voie Royale – qui semblent bien des « pauses ». La luminosité diminue, la musique change profondément de registre, les dialogues disparaissent et laissent place à des regards plus profonds, des gestes plus vraisemblables, le message est clair : finie la comédie. Sans un mot, une parenthèse de poésie vient nous rappeler que derrière l’excès se cache une catastrophe beaucoup plus profonde – gambinienne peut-être ? – la catastrophe de la responsabilité.
Car aucun des deux Direktørs n’assume tout à fait son autorité. La hiérarchie est ici conçue comme profondément subjective, tropique et donc tout à fait invisible. Au-delà du Direktør, c’est le metteur en scène qui semble disparaître et laisser à ses personnages un trop-plein d’espace dans lequel toute décision paraît impossible.
Qui sont d’ailleurs vraiment ces personnages ? Et qui sont ces acteurs qui n’en font pas un peu trop, mais dix fois trop ? Cette esthétique de la roue libre nous confronte à un spectacle qui semble en train de se monter : chacun doute en permanence du degré de jeu de l’autre et voilà la texture même de la représentation devenue irréelle, le monde si horizontal que plus personne n’y comprend grand-chose. Dans un joyeux paradoxe, le seul personnage jouissant d’une certaine vraisemblance c’est celui qui ne questionne pas sa fictionnalité, lucide sur les rôles que la société nous impose. « All the world’s a stage » : c’est tout le génie de l’interprétation que livre Gómez Mata du film de Lars von Trier : le monde est une scène comique, où il n’y a que des textes préécrits, où la poésie et le tragique ne peuvent résider que dans le non texte, presque le non langage et c’est là qu’est toute la joie du monde. Aussi, cette comédie « tout ce qu’il y a de plus inoffensive » est-elle profondément intelligente en ce qu’elle nous confronte au paradoxe d’une autorité qui nous demande de lâcher prise.
Le personnage chez von Trier était humain, trop humain, taillé en pièce par le comique aigre de sa modernité. Le personnage chez Gómez Mata rit tant de lui-même qu’il n’a finalement plus envie d’être humain. Il préfère devenir un cheval, ne pas parler puisque le langage est risible et galoper sur la scène en sautant par-dessus des chaises, à l’image de Mette (Claire Deutsch) dans la scène finale. Si la lisibilité de la structure fictionnelle s’efface, c’est sans doute pour nous faire comprendre que le véritable metteur en scène, c’est Gambini lui-même. Et Gambini n’existe pas.