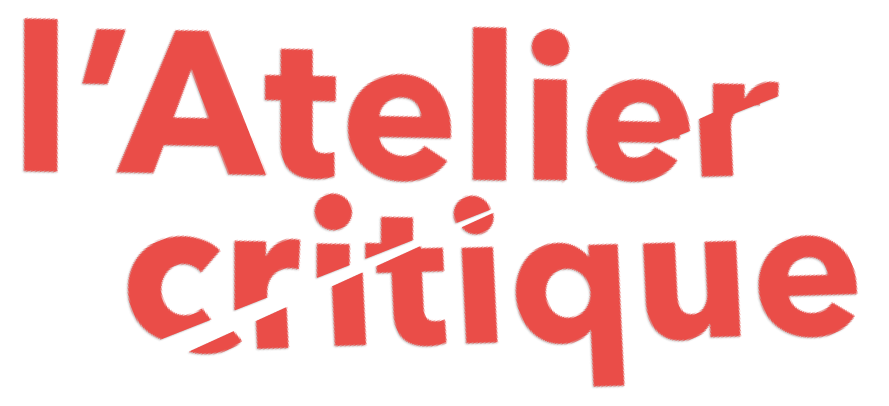Par Lucien Zuchuat
Une critique sur le spectacle :
Roméo et Juliette / De William Shakespeare / Mise en scène d’Omar Porras / TKM / du 19 septembre au 8 octobre 2017 / Plus d’infos

En ouverture de sa nouvelle saison au TKM, le plus colombien des metteurs en scène romands propose un Roméo et Juliette à la sauce japonaise. Foutraque et survolté, le spectacle réjouit plus qu’il n’emporte.
La salle est comble ; on s’impatiente : d’un côté, Omar Porras, bateleur très officiel de la région lémanique, roi de l’émerveillement avec ses masques et ses fantaisies baroques, de l’autre, Roméo et Juliette, ou plutôt « Julietu », car si les célèbres amants revivent encore leur triste histoire, c’est en japonais cette fois, dans un Vérone aux couleurs de Tokyo. La rencontre s’annonce étincelante.
De la farce avant toute chose
Et des étincelles, sans doute, il y en a eu… mais pas où on les attendait. D’emblée, le spectacle annonce sa couleur : ce sont le rire et le rythme qui assureront la cérémonie. Tous les détails de ce Roméo et Juliette, dont le texte est considérablement coupé, semblent passés au crible de la farce. Acrobatiques ou loufoques, les effets ne manquent pas qui laissent le public hilare : traitement truculent des personnages secondaires, chorégraphies rythmées et désopilantes qui ne sont pas sans rappeler les lazzi de la meilleure tradition italienne, utilisation inventive et joueuse des décors qui font apparaître, en quelques traits, une cour intérieur, un jardin zen, une crypte,… Le tout s’envole dans un chassé-croisé de tableaux colorés qui ne laissent de surprendre par leur inventivité.
La langue, elle aussi, participe de ces joyeuses et captivantes réjouissances. Le débit millimétré du japonais, dont on suit sans trop de peine la traduction sur deux écrans, alimente l’impression générale de vitesse et donne lieu à quelques habiles quiproquos linguistiques : quand la nourrice répète, sans les comprendre, des morceaux d’une tirade de Frère Laurent (le rôle étant interprété en français comme celui de Pâris), le public se tord.
Un Japon de bric et de broc
Mais, passée cette première impression d’étrangeté liée à la langue, d’ailleurs vite ravalée par la machinerie comique, les nipponeries de Maître Porras peinent à enchanter : louvoyant sans cesse entre une approche historique ravivant le temps des chevaliers d’Edo et une lecture contemporaine, le spectacle s’inscrit dans un Japon de bric et de broc mêlant geishas et mangas et qui s’avère finalement très convenu.
Certes, dans l’ensemble, la transposition résiste (prouvant, s’il le fallait encore, l’universalité du texte de Shakespeare) et donne même lieu à de séduisantes propositions : les scènes de combat au sabre réinterprétant avec vigueur et gravité les querelles meurtrières qui rongent Capulet et Montaigu ou les apparitions fantastiques du prince, monstre à la voix ravagée, qui administre la cité juché sur une haute colonne enfumée, exploitent toute la force ou la magie que la pièce recèle.
Au-delà de ces fulgurances, toutefois, le bouleversement culturel tant espéré ne se confirme pas. Et Shakespeare de demeurer familier… même le jeu outré (dans lequel les acteurs excellent par leur sens du rythme et de la posture), qui pourrait rappeler l’emphase du kabuki, renvoie plus à la commedia dell’arte et, confinés dans des types « universels », les personnages principaux, très classiques, semblent presque fades. Le Japon de Porras (hélas !) ne dépayse pas.
On finit même par se perdre dans ce syncrétisme désincarné, plus japonisant que japonais, empruntant sans ambages et à la tradition de l’estampe (que ce soient les lignes épurées du dojo qui enclot la scène ou les élégantes scènes d’intérieur à paravent et ombres plaquées) et à la plus chatoyante des cultures pop (karaoké et perruques folles à la Dragon Ball Z sont de mise)… une profusion qui, à force de grossir le trait et de chercher le décalage farcesque, étouffe la profondeur tragique de la pièce.
Un tragique à contre-courant
Le Roméo et Juliette de Porras nous honore certes de moments graves et lyriques : la très jolie scène du balcon, devenue scène du jardin japonais, émeut par son minimalisme, et la douleur des deux amants, Juliette plongeant dans le noir absolu son long voile de mariée à la main et Roméo courant à sa perte dans une danse macabre flottant parmi des lampions, est rendue avec une finesse poétique qui touche au sublime, sans parler de la fin, merveilleusement percluse de silence.
Mais ces moments de calme et de secret, durant lesquels la mécanique comique s’enraie un instant, demeurent (trop) rares et ne parviennent jamais vraiment à déborder le cadre de l’apparition furtive, à imposer leur durée propre dans le flux magistral du rire. Fait d’autant plus frustrant que c’est dans leur déroulement que la rencontre entre les cultures s’opère le plus sensiblement et apporte la plus douce des lumières au texte du dramaturge élisabéthain. En fin de compte, confinée à ce rôle épisodique, figée dans le royaume de l’esthétique, la poésie passe comme passent les images : sans toucher pleinement.
Pire ! Certains passages hautement kitsch (la fiole de poison brillant d’un bleu translucide, la première rencontre de Roméo et Juliette célébrée par une farandole simplette) confineraient presque au ridicule, si la naïveté figée des protagonistes n’apparaissait pas, emportée dans la dynamique joyeuse de l’ensemble, comme une touchante maladresse adolescente : devant tant de générosité et d’inventivité, on oublie facilement ces quelques lourdeurs, on admire et on rit sans bouder notre plaisir. Mais, en fin de compte, on ne vibre pas.