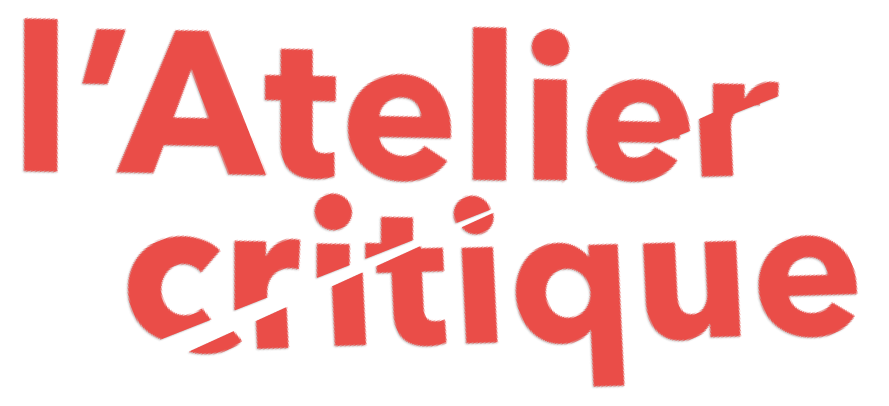Par Jérémy Berthoud
Empire / Milo Rau / Théâtre de Vidy / du 5.10 au 8.10.2016 / Plus d’infos

Après The Civil Wars et The Dark ages, le metteur en scène Milo Rau présente Empire, dernier volet d’une trilogie consacrée à l’Europe. Dans ce dernier opus, l’accent est mis sur la quête d’une identité européenne commune, polyglotte et pluriculturelle.
Quatre comédiens de quatre horizons culturels différents se posent sur une chaise et racontent quelques fragments de leur existence, tantôt solaire, tantôt sèche comme la poussière, dans leur langue maternelle, grecque, roumaine, kurde et arabe (sous-titrées en français). Akillas, Maia, Ramo et Rami. Akillas joue des tragédies, Maia a tourné dans La Passion du Christ de Mel Gibson, Ramo a passé quelques mois en prison et Rami cherche son frère disparu sous le régime syrien. Ce qui les sépare tous quatre, c’est leur parcours, marqué à différents niveaux par la religion, la politique ou le voyage ; ce qui les rassemble, c’est leur métier de comédien.
Ce statut ambigu de témoin-comédien pose un certain nombre de questions : ce qu’ils partagent sur scène relève-t-il de la fiction ou du réel ? Où se trouvent les limites entre ces deux catégories ? Avons-nous affaire à des personnages de théâtre, des comédiens qui jouent ou tout simplement des humains ? Sans doute un mélange des trois, un mélange entre la fragilité des émotions et la sécurité d’un plateau de théâtre où ce qui se passe a été répété. Régulièrement les comédiens rappellent qu’il s’agit d’un spectacle et rejouent parfois des scènes de leur vie, prenant véritablement les rôles de leurs interlocuteurs : Maia nous fait revivre un tournage à Auschwitz et Ramo met sous nos yeux son passage en prison. Pour troubler davantage encore les catégories, le décor, petit appartement une pièce, est à la fois très impersonnel et profondément intime : à ce que disent nos quatre protagonistes, certains objets leur appartiennent. Quant aux costumes, les intervenants portent sans doute leurs propres vêtements mais ils gardent les mêmes tous les soirs…
De langues différentes, tous quatre s’écoutent tout de même les uns les autres, se répondent, se retrouvent dans la vie des autres ; « comme toi, j’ai vécu ceci… », tissant des liens de connivence profonds, cherchant derrière l’apparence des mots la marque qui les rend tous humains. A cette complicité de paroles s’ajoute une complicité de plateau intimement liée au dispositif scénique : alors que trois d’entre eux se tiennent dans la petite chambre du décor, le quatrième se place systématiquement derrière une caméra et filme leur visage qui est projeté sur grand écran. Lorsqu’un des « narrateurs » parle, il s’adresse à la caméra et, peut-être aussi, à celui qui se tient derrière.
Ce dispositif de caméra, filmant les visages en plans serrés en noir et blanc, n’est pas sans rappeler le fonctionnement d’un documentaire. S’ajoutant à la voix, différents objets et souvenirs, fonctionnant comme autant de sources historiques, amplifient cet aspect : il y a la médaille de Ramo, les photos des morts du régime syrien, projetées sans filtre, une vidéo-amateur prise dans un cimetière…
Comme les comédiens jouent face à la caméra, les figures sur l’écran semblent nous regarder directement, créant avec chaque membre du public une proximité forte et l’impression d’être seul avec eux. Le lien, empli de respect mutuel, se teinte parfois de violence lorsque, par exemple, Maia se frappe la tête contre l’armoire, produisant une onde de choc à travers les rangées de sièges du théâtre. Il devient angoissant lorsque les photos des morts défilent alors que Rami cherche celle de son frère disparu. Il s’emplit de joie lorsqu’Akillas nous donne à voir son « minimalisme dépressif », c’est-à-dire une face inexpressive ponctuée d’un silence significatif, grâce auquel il a décroché son premier rôle au théâtre.
Le spectacle n’est pas uniquement ancré dans le présent de la salle, il s’étire aussi jusqu’au passé : divisé en cinq parties, il s’inspire de la structure en cinq actes de la tragédie classique. Il remonte même jusqu’aux racines grecques du théâtre, lorsque Maia et Akillas interprètent un extrait de la Médée d’Euripide. Maia est placée sur un balcon situé derrière le décor et filmé. Nos deux comédiens ne joueront donc pas face-à-face mais mot-à-mot. L’une sur l’écran, l’autre sur le plateau juste en dessous, rappelant la fin de Médée qui, après avoir tué ses enfants, s’envole sur le char du soleil, s’éloignant de la terre où tout le monde, y compris Jason son mari, la traitait en étrangère.
Voilà touché le dernier point : la distance. Celle d’une culture à une autre, de Médée la barbare (au sens d’étrangère) à Jason le grec, de Maia à Akillas, du passé au présent. Le noir et le blanc de la vidéo et les témoignages appartiennent au passé et nous frappent au présent, atténués par le temps. Le décor à deux faces, tourné d’abord côté balcon (imbriqué dans une paroi d’un immeuble délavé), a été retourné côté appartement au tout début du spectacle, passant ainsi de l’impersonnalité lisse et convenue d’une vieille façade à l’intimité d’un appartement et de quatre témoins, amenant avec eux leur force, leurs émotions et, surtout, leur fragilité, marque universelle de notre humanité.