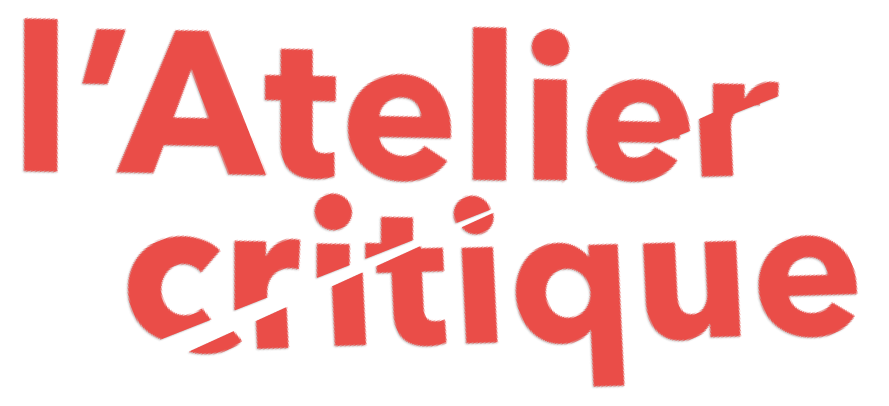Les Palmiers sauvages / D’après Les Palmiers sauvages (ou Si je t’oublie Jérusalem) de William Faulkner / mise en scène Séverine Chavrier / du 25 septembre au 12 octobre 2014 / Théâtre Vidy Lausanne / plus d’infos

Un couple expérimente la passion amoureuse : dans cette adaptation d’une nouvelle de l’Américain William Faulkner, publiée en 1938, la Française Séverine Chavrier fait le choix d’une mise en scène contemporaine. Sa puissante composition d’images prend toutefois le risque d’emprisonner le texte.
Corps nus, matelas envahissant le plateau comme pour former un monochrome sur lequel s’aimer, cris, sauts, refus de routine : la flamme est là. Charlotte (la Belge Deborah Rouach, fraîche et spontanée) a quitté enfants et mari pour Harry (Laurent Papot, qui rythme la pièce avec talent), un interne en médecine de trente-trois ans. Ce dernier est encore vierge lorsqu’il la rencontre et il s’agit de rattraper le temps perdu. Charlotte avance que s’ils s’aiment suffisamment fort, elle ne tombera pas enceinte, « car la passion brûle tout ».
C’est néanmoins un avortement qui viendra achever leur chemin de croix amoureux. Peu à peu, ils se perdent, ne se comprennent plus et semblent étouffer dans un espace scénique pourtant entièrement exploité. Tout s’effrite, plus rien ne va de soi. « Combien de fois on a fait l’amour, en tout ? Combien de fois on fait l’amour dans toute une vie ? » demande inlassablement Charlotte. Les élans de leurs chairs nues semblent ne plus suffire à l’expression de leur amour. Corps et âme s’épuisent de trop de passion.
Les deux comédiens portent des micros : si cela permet un jeu particulièrement fin, en contraste avec leurs explosions, cette médiation crée pour le spectateur une distance presque cinématographique, encore amplifiée par de très nombreuses projections : en noir et blanc, une jetée, un orage, Harry, fou, qui marche sur la plage et plus tard, son corps ballotté par les flots. Parfois, l’écran offre un autre point de vue sur le plateau, capturé en direct depuis le côté, ou une vision en infra-rouge, lorsque le noir se fait. L’image sera encore celle que renvoie le caméscope de Charlotte, qui joue à se filmer en gros plan. Les ambiances sonores créées par Philippe Perrin, auxquelles se joint la musique d’un vieux tourne-disque, achèvent quant à elles de donner un relief cohérent à cet univers très travaillé.
L’esthétique que parviennent à créer Séverine Chavrier et son scénographe Benjamin Hautin est intense. La régie lumière rend justice à un décor foisonnant (boîtes de conserves, chaises, matelas, couvertures et bouteilles : tout s’entasse) et les panneaux arrières de la salle René Gonzales à Vidy finissent par s’ouvrir sur l’imposant feuillage du platane de l’allée du théâtre. Cette nouvelle fenêtre sur le monde nous permet de quitter un instant ce huis-clos, cette prison amoureuse. La salle peut respirer. La nature, jusqu’ici suggérée, se fait bien réelle.
La nouvelle du Prix Nobel Faulkner est double et les chapitres de deux histoires s’entrecoupent sans jamais se rejoindre. Si c’est l’intrigue des Palmiers Sauvages qui a été choisie, l’ambiance tumultueuse du Vieux Père a été conservée : un détenu y lutte contre les eaux du Mississipi pour sauver une femme enceinte. Le pouvoir de la nature nous est sans cesse rappelé.
« Comment rendre sur scène ces traces ou signes d’une histoire naturelle en décomposition à l’image des paysages dont la multiplication des angles de vue ne donnera jamais qu’un aperçu tronqué ? » se demande Séverine Chavrier dans sa note d’intention. Le défi était en effet de taille. En voulant illustrer sous tant d’angles, par tant de dispositifs, la prose faulknerienne, l’adaptation néglige de nous transmettre son texte et ôte à ce théâtre son lien tangible au public.
Pas toujours assez audacieuse dans son aspect contemporain, cette mise en scène aurait sans doute gagné à assumer ses timides adresses aux spectateurs – en abattant plus violemment le quatrième mur – et à salir et encombrer d’avantage encore son plateau, à la manière d’un Macaigne ou d’un Ostermeier, bref : à aller jusqu’au bout de ses choix, ou alors, au contraire, à insister sur cette sensation d’enfermement des personnages, sur ces corps minuscules pris dans une nature qui les dépasse. Si Séverine Chavrier est une habituée du travail littéraire, il est ici difficile de déterminer exactement sous quel(s) vent(s) ses Palmiers sauvages souhaitaient nous emmener.
Reste l’image, sublime, de cette passion dont on finit par mourir ne pouvoir la vivre.